Suite et fin d'un dialogue à bâtons rompus entre Janique Jouin et Alexia Valembois, sous les bons auspices de LIse Garond.
– Lise : Est-ce qu’il vous arrive de proposer des choses à traduire ? Et est-ce que ça a déjà marché ? Une des seules façons de commencer à traduire quand on n’a pas de réseau, c’est de proposer quelque chose.
– Janique : Moi, ça n’a jamais marché. À chaque fois, c’est quelqu’un d’autre qui traduit. Je n’ai jamais proposé au bon éditeur. C’est toujours un autre éditeur qui le sort, comme Doug Johnstone, ou Tom Bouman, je l’avais proposé à plusieurs éditeurs, et c’est Actes Sud à qui je ne l’avais pas proposé qui l’a publié. Mais le pire, ça a été au début, avec un auteur de Phoenix dont j’avais traduit des nouvelles pendant mon master de traduction. J’avais beaucoup sympathisé avec lui et je voulais absolument que ce soit publié, je trouvais ça tellement bien. Je l’ai proposé à des éditeurs, mais je débarquais dans le milieu, je ne connaissais pas grand monde. Je l’ai proposé à Aurélien Masson qui était à la Série Noire à ce moment-là. On s’était rencontrés à Quais du polar, on avait sympathisé, et il avait lu le livre sur les Ramones, parce que c’est un grand fan des Ramones. Je lui avais proposé cet auteur et, sur le moment, il m’avait dit qu’il ne publiait pas d’auteurs américains, mais de lui envoyer quand même le bouquin, qui était introuvable. Et puis bon, pas de nouvelles. Je l’avais proposé aussi à Terres d’Amérique et à d’autres, mais personne n’en voulait. Trois ans plus tard, je recroise Aurélien à Quais du polar. Et il me dit : « Ah ouais, attends, il faut que je te dise un truc... » Il était allé aux États-Unis, et là quelqu’un lui avait passé une novella du même auteur, Patrick Michael Finn. Il avait trouvé ça génial et en avait parlé à une copine traductrice qui voulait le traduire. Finn lui avait répondu qu’il voulait que ce soit moi sa traductrice. Mais Aurélien avait déjà proposé à l’autre. J’étais folle de rage. Et donc il me dit qu’il est désolé et que, pour compenser, il aurait peut-être autre chose à me proposer : Peckerwood, de Jedidiah Ayres. C’était un auteur inconnu, mais justement je l’avais lu. J’accepte, mais une semaine plus tard, il m’envoie un message où il me dit qu’il a un ami traducteur qui a absolument besoin de travail et que, finalement, c’est lui qui va le traduire. Voilà, c’est sorti, et il a publié un autre roman de Patrick Michael Finn, mais les nouvelles n’ont jamais été publiées.
– Lise : Et toi, Alexia, ça t’est aussi arrivé de proposer quelque chose ?
– Alexia : Moi, c’était au tout début, quand je faisais beaucoup de lectures. Le Goethe Institut à Bordeaux avait un bulletin, le « Courrier de littérature allemande » qui présentait des comptes-rendus de livres, et ils m’avaient confié un bouquin que j’avais bien aimé, Der Geschmack von Apfelkernen, « le goût des pépins de pomme ».
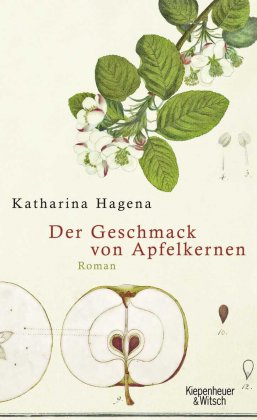 J’avais fait la fiche de lecture et un petit essai de traduction. Puis je l’ai envoyé à droite et à gauche, et j’ai contacté l’agent de la maison d’édition, qui avait un agent à Paris. Quand je l’ai contactée, l’agente m’a dit de lui envoyer ma fiche de lecture et mon essai de traduction, et qu’elle relaierait auprès de l’éditeur qui achèterait le livre pour le traduire en français. J’étais trop contente. Je lui envoie tout ça, puis je n’ai plus aucune nouvelle. À l’été, le bouquin sort en français, traduit par quelqu’un d’autre. Et la quatrième de couverture, c’était ma fiche de lecture ! J’étais furax. Je m’étais fait embobiner par cette agente. J’ai appelé chez Anne Carrière, la maison d’édition française. Je demande : « C’est qui chez vous qui a écrit la quatrième de couverture ? » On me répond : « J’en sais rien, pourquoi ? » Je dis : « C’est moi qui l’ai écrite ! Reprenez le dossier. » Elle me dit : « Oui, j’ai un dossier, mais c’est l’agent qui me l’a fait parvenir, il y a son nom partout, votre nom n’apparaît nulle part. On n’a jamais su que vous existiez. Je suis absolument désolée. » L’agente littéraire avait enlevé mon nom partout et mis le sien. Elle ne l’a pas traduit, c’est quelqu’un d’autre qui l’a traduit, mais quand même. Après, je ne sais pas s’ils m’auraient confié le livre parce que j’étais une jeune traductrice. Ça a été très bien traduit d’ailleurs, par une traductrice qui a été présidente de l’ATLF et qui travaillait déjà pour cette maison d’édition. Mais ils n’ont jamais eu conscience qu’il y avait eu quelqu’un d’autre.
J’avais fait la fiche de lecture et un petit essai de traduction. Puis je l’ai envoyé à droite et à gauche, et j’ai contacté l’agent de la maison d’édition, qui avait un agent à Paris. Quand je l’ai contactée, l’agente m’a dit de lui envoyer ma fiche de lecture et mon essai de traduction, et qu’elle relaierait auprès de l’éditeur qui achèterait le livre pour le traduire en français. J’étais trop contente. Je lui envoie tout ça, puis je n’ai plus aucune nouvelle. À l’été, le bouquin sort en français, traduit par quelqu’un d’autre. Et la quatrième de couverture, c’était ma fiche de lecture ! J’étais furax. Je m’étais fait embobiner par cette agente. J’ai appelé chez Anne Carrière, la maison d’édition française. Je demande : « C’est qui chez vous qui a écrit la quatrième de couverture ? » On me répond : « J’en sais rien, pourquoi ? » Je dis : « C’est moi qui l’ai écrite ! Reprenez le dossier. » Elle me dit : « Oui, j’ai un dossier, mais c’est l’agent qui me l’a fait parvenir, il y a son nom partout, votre nom n’apparaît nulle part. On n’a jamais su que vous existiez. Je suis absolument désolée. » L’agente littéraire avait enlevé mon nom partout et mis le sien. Elle ne l’a pas traduit, c’est quelqu’un d’autre qui l’a traduit, mais quand même. Après, je ne sais pas s’ils m’auraient confié le livre parce que j’étais une jeune traductrice. Ça a été très bien traduit d’ailleurs, par une traductrice qui a été présidente de l’ATLF et qui travaillait déjà pour cette maison d’édition. Mais ils n’ont jamais eu conscience qu’il y avait eu quelqu’un d’autre.
– Lise : Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre « décor de traduction », le cadre dans lequel vous travaillez ? Parce que ce n’est pas seulement un métier intellectuel, en fait, c’est aussi un peu physique, on a souvent mal à la nuque, mal au dos... Est-ce que vous avez un bureau, un coin bureau ?
– Alexia : J’ai une super chaise où je suis très bien installée, mais dont j’ai cassé le dossier, il va falloir que j’en change. Je crois que j’ai toujours traduit avec cette chaise. C’est important en fait, ma chaise. Il faut qu’elle soit assez large pour que je tienne en tailleur. À côté, il y a le fauteuil du chat. Parce qu’il traduit avec moi toute la journée. Et j’ai une grande bibliothèque en mezzanine. Ce qui est hyper pratique, c’est aussi que j’ai une porte blindée, en fait. Aucun bruit ne passe. Ça matérialise bien mon domaine.
– Janique : Moi je suis un peu comme toi, je suis toujours assise n’importe comment, avec une seule jambe dessous, je ne sais pas tenir assise. Il est tout déglingué mon fauteuil aussi. Mais maintenant, j’ai un vrai grand bureau, qui fait douze mètres carrés, avec une grande fenêtre qui donne sur la cour. Avant, je travaillais dans ma véranda, où il n’y avait pas de chauffage. Il faisait quarante degrés l’été et treize l’hiver. Et c’était tout petit. Donc maintenant, j’ai un grand bureau avec des meubles que j’ai chinés. Ça fait très années cinquante. Il y a plein de place, un canapé. Parce que la véranda, c’était cinq mètres carrés, j’avais tout le temps l’impression d’être à l’étroit, j’étais coincée entre les toilettes et la cuisine. C’est comme ça que j’ai commencé à garder des chats. Avec mon ordi, je me suis dit que je pouvais aller travailler un peu partout. Et c’est vrai que j’avais tout le temps des grandes maisons pour moi toute seule. Pour le coup, c’était tranquille. Une fois, j’étais à Fontarrabie, avec vue sur la mer. Pareil à Édimbourg, j’étais chez une dame en hauteur avec vue sur l’eau, la plage. Maintenant, c’est vrai que je le fais moins parce que j’ai un grand bureau, de la place, un canapé pour le chat.
– Lise : Et quel est votre processus de travail, parce que tout le monde n’a pas le même. Vous avez plutôt tendance à faire un premier jet d’une traite pour avoir une première vision d’ensemble sur laquelle revenir ensuite, ou à faire dès le début une version relativement aboutie, petit à petit ?
– Alexia : Moi, je n’aime pas écrire quelque chose qui n’est pas proche de ce qui pourrait être définitif. En plus, avec l’allemand, il y a de gros décrochages. Si tu commences à écrire une version un peu trop littérale, tu risques de bloquer dessus et d’avoir du mal à t’en détacher, donc j’évite de l’écrire. À la limite, je le pense, mais je ne vais pas l’écrire. Disons que je ne suis pas réputée pour ma rapidité. Mais quand c’est fait, c’est fait. J’ai traduit de l’anglais cet été, et ce n’est pas pareil avec l’anglais. Mais avec l’allemand, tu dois toujours faire le deuil de tout un tas de choses présentes dans le texte source. C’est quelque chose qu’on acquiert avec l’expérience, et que j’avais plus de mal à faire lors de mes premières traductions. Les étudiants ont souvent ce problème. Il y a tellement de choses dans le texte source. On n’arrive pas à tout mettre dans le texte cible. Si tu commences à tout écrire, ça devient illisible. Il y a en particulier toutes ces petites prépositions, qui suggèrent que le soleil, il arrive par là, mais non, en fait l’eau remonte par là… Il y a une profusion de détails en allemand. Le français est une langue à contexte fort, et l’allemand une langue à contexte faible. Ça veut dire que, quand tu prends un texte allemand, tu as beaucoup moins de choses à aller chercher dans le contexte. Tout est dans le texte. En français, il y a des tas de choses qui ne sont pas dites, elles sont dans cet espace contextuel qu’on partage tous, parce qu’on parle la même langue, et ça, c’est une grosse différence.
– Lise : Donc quand tu passes au français, il y a des choses que tu enlèves un peu ?
– Alexia : Est-ce que tu les enlèves ? Je ne sais pas. Par exemple, est-ce que tu as besoin de préciser que tu te lèves toujours en faisant ce mouvement-là, comme on peut dire en allemand ? Quand tu te lèves, tu te lèves. Tu n’as pas besoin de te lever dans ce sens-là. Il s’agit juste de retrouver un peu de familiarité avec ta langue à toi et faire le deuil de ce que tu perds de la langue source.
– Janique : En anglais aussi, ils précisent tout le temps, par exemple look down, est-ce qu’il faut préciser à chaque fois qu’on regarde en bas ?
– Lise : Et puis ils haussent les épaules tout le temps en anglais.
– Janique : Oui, et puis ils remuent la tête. Qu’est-ce qu’ils ont tout le temps à hocher la tête ?
– Lise : Moi, des fois, j’en enlève.
– Alexia : Voilà, et quand tu arrives à faire ça sans te sentir traître, c’est un bon progrès, et surtout ça ne nuit pas du tout au texte cible. C’est ça, le principal, avoir assez d’assurance pour le faire, mais pas trop non plus.
– Lise : Ça, ça vient avec le temps. Et toi, Janique, est-ce que tu as tendance à faire un premier jet d’ensemble ou pas ?
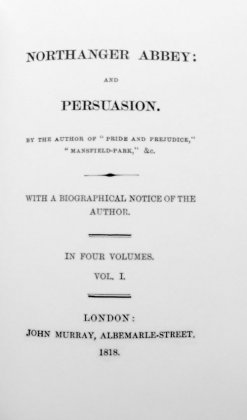 – Janique : Je fais un premier jet d’ensemble, mais j’essaie quand même qu’il soit à peu près bien. Et je relis petit à petit. Mettons que je fais un chapitre par jour, puis je le relis, je corrige tout ce qui peut être corrigé. Dernièrement, je suis passée d’une retraduction de Persuasion de Jane Austen à Jennifer Haigh. Avec Jane Austen, je relisais quatre fois au minimum chaque phrase, voire dix, pour arriver à comprendre ce qu’elle voulait dire. Je n’allais vraiment pas vite. Une fois que j’avais à peu près compris la phrase qui faisait près de trois quarts de page à chaque fois, avec ses dix-huit propositions, que j’avais remis ces dix-huit propositions dans le bon ordre en français… Je n’ai jamais été aussi lente. Il fallait que je travaille complètement différemment de d’habitude. J’étais obligée d’avoir vraiment quelque chose d’à peu près abouti dès le début. Et encore le lendemain, je relisais le chapitre traduit la veille et je me rendais compte que certaines phrases ne voulaient rien dire.
– Janique : Je fais un premier jet d’ensemble, mais j’essaie quand même qu’il soit à peu près bien. Et je relis petit à petit. Mettons que je fais un chapitre par jour, puis je le relis, je corrige tout ce qui peut être corrigé. Dernièrement, je suis passée d’une retraduction de Persuasion de Jane Austen à Jennifer Haigh. Avec Jane Austen, je relisais quatre fois au minimum chaque phrase, voire dix, pour arriver à comprendre ce qu’elle voulait dire. Je n’allais vraiment pas vite. Une fois que j’avais à peu près compris la phrase qui faisait près de trois quarts de page à chaque fois, avec ses dix-huit propositions, que j’avais remis ces dix-huit propositions dans le bon ordre en français… Je n’ai jamais été aussi lente. Il fallait que je travaille complètement différemment de d’habitude. J’étais obligée d’avoir vraiment quelque chose d’à peu près abouti dès le début. Et encore le lendemain, je relisais le chapitre traduit la veille et je me rendais compte que certaines phrases ne voulaient rien dire.
Mais sinon, en général, je traduis et je relis chapitre par chapitre, en essayant que ça soit à peu près bien. Mais ensuite, je relis encore beaucoup, entre six et huit fois. Jusqu’à ce que je sois satisfaite. C’est comme Carver qui disait qu’il relisait ses nouvelles jusqu’à ce qu’il remette les virgules à la même place. Jusqu’à ce qu’il n’ait plus besoin de rien bouger, en fait. Je relis jusqu’à ce que je n’aie plus rien à changer. Pendant le premier jet, je travaille beaucoup. Dix, onze heures par jour. Je m’arrête à midi, je mange un truc vite fait et je recommence. Par contre, quand je relis, je ne peux pas travailler autant. Si tu relis pendant dix heures, tu ne vois plus rien au bout d’un moment. En général, je fais une relecture complète. Puis je passe le fichier dans Antidote pour voir les répétitions. Tu crois que tu as éliminé toutes les répétitions, mais quand tu le passes dans Antidote, il y en a partout.
– Alexia : Moi, je n’utilise pas Antidote, je fais ma correction avec Word. Pour la relecture, j’utilise un truc appris au Goldschmidt : quand j’ai commencé ce programme, je savais traduire, globalement, je n’y ai pas appris à traduire. J’ai appris à lire. Ce qu’on faisait souvent, c’était relire à haute voix.
– Janique : Je le fais tout le temps, je relis toujours à haute voix, surtout pour les dialogues, pour que ça sonne bien. Si ça accroche sur un mot c’est que ça ne va pas, il faut changer. Persuasion, je l’ai lu deux fois à haute voix. Je crois que n’ai jamais autant bossé sur une traduction. C’est assez court, trois cents feuillets, mais j’ai quand même mis quatre mois.
– Lise : Oui, enfin, trois cents feuillets, ce n’est pas rien, et puis Jane Austen c’est quand même un monument. C’est intimidant aussi.
– Janique : C’est ça, parce que quand Gallmeister me l’a proposé, j’étais là : « Non mais ça va pas ? T’es sûr, Oliver ? » Il m’a dit oui, oui. J’ai dit : « Je vais te faire un essai. Et puis je vais le relire déjà, en anglais. »
– Lise : Est-ce que tu as comparé avec les autres traductions existantes ?
– Janique : Non, enfin si, j’en ai une à la maison. C’est une traduction de 1945 qui est un peu lourde, mais quand même, de temps en temps, je regardais pour voir si j’avais bien compris, si le traducteur avait compris comme moi la phrase. Mais je ne voulais surtout pas voir les autres. Parce que je sais qu’il y en a une à la Pléiade, quand même. Et je me disais, mais pourquoi Gallmeister veut qu’on refasse ça ?
– Lise : Mais ça te plaisait quand même ?
– Janique : Le défi, oui, parce que j’avais lu Jane Austen, et j’aime bien ça. Mais c’était un sacré défi quand même : je n’ai pas fait d’études d’anglais, je ne suis pas spécialiste de l’Angleterre, beaucoup plus des États-Unis. Pas du tout du dix-neuvième. Enfin… je ne suis spécialiste de rien. Chaque fois que tu lis les biographies des gens qui ont traduit, c’est genre des spécialistes de la littérature victorienne, moi je ne suis spécialiste de rien. Bon, finalement, ils ont été ravis de ma traduction. Inès Gallmeister, qui l’a entièrement relue, ne m’a renvoyé que très peu de corrections.
– Alexia : Chez les germanistes, le monument, c’est Kafka. Dans un texte, dès qu’il y a la moindre référence à Kafka, je ne sais pas pourquoi, ça me terrorise. Traduire un auteur comme ça, c’est particulièrement une traduction sous contraintes… Vous avez vu le thème des prochaines Assises d’Arles en 2025, d’ailleurs ? « La traduction sous contraintes ». Va traduire La Disparition de Perec !
– Lise : Est-ce que vous n’avez pas l’impression que traduire, justement, c’est un peu écrire sous contraintes ?
– Alexia : J’ai toujours du mal avec ce « écrire » parce que tu n’as pas cette part de création, d’invention du monde dans la traduction. Il y a une part d’écriture, certes, mais il ne s’agit pas encore de cette chose-là : faire tenir un monde ensemble. J’ai fait un atelier d’écriture aux dernières Assises à Arles. Il fallait imaginer un être organique, mais qui n’était pas humain. En imaginant son point de vue. Ça, c’est bien comme contrainte, ça te permet de te lancer. Tu peux écrire un peu. C’est tout ce travail d’imagination que tu n’as pas à faire quand tu traduis.
– Janique : Voilà, c’est ça, moi j’ai du mal à imaginer. Quand j’étais jeune, j’avais plein d’idées, j’écrivais des nouvelles tout le temps, j’ai des dizaines de nouvelles à la maison. J’ai écrit des romans que je n’ai jamais relus. Ils étaient dans un tiroir, je les ai retrouvés en déménageant. Quand j’étais petite, si on me demandait ce que je voulais faire, je disais « je veux être écrivain ». Après, j’aime bien écrire, mais traduire c’est plus rigolo, tu passes d’un style à l’autre.
– Lise : C’est rassurant en effet de ne pas avoir tout à inventer, de n’avoir « que » les mots à trouver, mais finalement ça fait beaucoup, tous les mots à trouver !
– Janique : Quand on passe de Jane Austen, qui est quand même début dix-neuvième, avec ses imparfaits du subjonctif, à Jennifer Haigh, aujourd’hui à Shanghai, ce n’est pas du tout la même langue. Alors là, du coup, Jennifer, ça me paraît super facile. Je comprends toutes les phrases, je comprends tous les mots. J’ai un peu de mal avec l’univers chinois, mais je n’ai pas besoin de relire quatre fois chaque phrase. Et puis elle écrit beaucoup avec des phrases courtes et incisives. Alors qu’avec Jane Austen, les phrases sont super longues et il faut quand même que ça reste fluide.
– Lise : Il y a une dernière question que je voulais vous poser, parce que c’est aussi par le biais de Matrana qu’on se connaît. Pour moi, c’est important, la vie associative, le fait de pouvoir se rencontrer entre traducteurs et traductrices, puisque c’est un métier quand même assez solitaire. Est-ce que ça joue un rôle important dans votre métier ?
– Alexia : Tu sais le dernier « café Matrana », quand cette copine est venue ? C’est une fille qui traduit depuis hyper longtemps. Nous, on était tous de Matrana, et les bonnes choses, tu t’y habitues tellement vite que tu ne t’aperçois pas à quel point c’est bien. C’est plus difficile quand tu n’as pas ce réseau. Juste parfois pour te décharger de tes angoisses avec un éditeur qui te fait des misères, et c’est ce qui lui arrive à cette copine. Elle a pourtant beaucoup publié, mais elle n’arrive toujours pas à négocier avec son éditeur, et elle était contente de pouvoir échanger là-dessus.

– Janique : Moi c’est vrai que j’ai débarqué dans ce milieu complètement… à cinquante ans, sans connaître personne. C’est quand même sympa de rencontrer des gens. D’abord, j’ai été à une joute de traduction organisée par Matrana. Et après j’ai fini par m’inscrire. Après, chez Gallmeister, ce qui est bien c’est qu’on n’est pas complètement isolé, il y a beaucoup d’auteurs en tournée tout le temps. Donc on se connaît tous, on connaît les auteurs, ils sont toujours en train de nous présenter les uns aux autres.
– Lise : La traduction est plutôt un métier solitaire, est-ce que vous, ça vous pèse ou pas du tout ?
– Alexia : Ah non, moi ça ne me pèse pas du tout.
– Janique : Moi, j’adore être toute seule ! Travailler toute seule. J’ai horreur de travailler avec des gens.
– Alexia : Moi, si je pouvais en vivre, je ne ferais que ça.
– Lise : Moi, j’aime bien l’équilibre entre être la plupart du temps toute seule, et de temps en temps participer à des rencontres associatives, aller à un festival. Pas trop, mais un peu quand même.
– Alexia : Juste pour que tu trouves ça bien. Et puis dès que tu commences à en avoir marre, tu retournes à ton travail !
– Janique : Moi, ça n’a jamais marché. À chaque fois, c’est quelqu’un d’autre qui traduit. Je n’ai jamais proposé au bon éditeur. C’est toujours un autre éditeur qui le sort, comme Doug Johnstone, ou Tom Bouman, je l’avais proposé à plusieurs éditeurs, et c’est Actes Sud à qui je ne l’avais pas proposé qui l’a publié. Mais le pire, ça a été au début, avec un auteur de Phoenix dont j’avais traduit des nouvelles pendant mon master de traduction. J’avais beaucoup sympathisé avec lui et je voulais absolument que ce soit publié, je trouvais ça tellement bien. Je l’ai proposé à des éditeurs, mais je débarquais dans le milieu, je ne connaissais pas grand monde. Je l’ai proposé à Aurélien Masson qui était à la Série Noire à ce moment-là. On s’était rencontrés à Quais du polar, on avait sympathisé, et il avait lu le livre sur les Ramones, parce que c’est un grand fan des Ramones. Je lui avais proposé cet auteur et, sur le moment, il m’avait dit qu’il ne publiait pas d’auteurs américains, mais de lui envoyer quand même le bouquin, qui était introuvable. Et puis bon, pas de nouvelles. Je l’avais proposé aussi à Terres d’Amérique et à d’autres, mais personne n’en voulait. Trois ans plus tard, je recroise Aurélien à Quais du polar. Et il me dit : « Ah ouais, attends, il faut que je te dise un truc... » Il était allé aux États-Unis, et là quelqu’un lui avait passé une novella du même auteur, Patrick Michael Finn. Il avait trouvé ça génial et en avait parlé à une copine traductrice qui voulait le traduire. Finn lui avait répondu qu’il voulait que ce soit moi sa traductrice. Mais Aurélien avait déjà proposé à l’autre. J’étais folle de rage. Et donc il me dit qu’il est désolé et que, pour compenser, il aurait peut-être autre chose à me proposer : Peckerwood, de Jedidiah Ayres. C’était un auteur inconnu, mais justement je l’avais lu. J’accepte, mais une semaine plus tard, il m’envoie un message où il me dit qu’il a un ami traducteur qui a absolument besoin de travail et que, finalement, c’est lui qui va le traduire. Voilà, c’est sorti, et il a publié un autre roman de Patrick Michael Finn, mais les nouvelles n’ont jamais été publiées.
– Lise : Et toi, Alexia, ça t’est aussi arrivé de proposer quelque chose ?
– Alexia : Moi, c’était au tout début, quand je faisais beaucoup de lectures. Le Goethe Institut à Bordeaux avait un bulletin, le « Courrier de littérature allemande » qui présentait des comptes-rendus de livres, et ils m’avaient confié un bouquin que j’avais bien aimé, Der Geschmack von Apfelkernen, « le goût des pépins de pomme ».
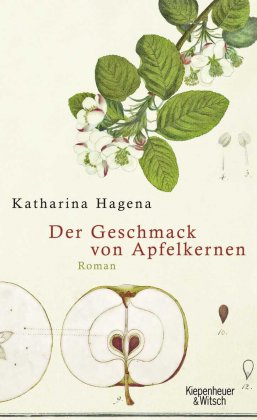 J’avais fait la fiche de lecture et un petit essai de traduction. Puis je l’ai envoyé à droite et à gauche, et j’ai contacté l’agent de la maison d’édition, qui avait un agent à Paris. Quand je l’ai contactée, l’agente m’a dit de lui envoyer ma fiche de lecture et mon essai de traduction, et qu’elle relaierait auprès de l’éditeur qui achèterait le livre pour le traduire en français. J’étais trop contente. Je lui envoie tout ça, puis je n’ai plus aucune nouvelle. À l’été, le bouquin sort en français, traduit par quelqu’un d’autre. Et la quatrième de couverture, c’était ma fiche de lecture ! J’étais furax. Je m’étais fait embobiner par cette agente. J’ai appelé chez Anne Carrière, la maison d’édition française. Je demande : « C’est qui chez vous qui a écrit la quatrième de couverture ? » On me répond : « J’en sais rien, pourquoi ? » Je dis : « C’est moi qui l’ai écrite ! Reprenez le dossier. » Elle me dit : « Oui, j’ai un dossier, mais c’est l’agent qui me l’a fait parvenir, il y a son nom partout, votre nom n’apparaît nulle part. On n’a jamais su que vous existiez. Je suis absolument désolée. » L’agente littéraire avait enlevé mon nom partout et mis le sien. Elle ne l’a pas traduit, c’est quelqu’un d’autre qui l’a traduit, mais quand même. Après, je ne sais pas s’ils m’auraient confié le livre parce que j’étais une jeune traductrice. Ça a été très bien traduit d’ailleurs, par une traductrice qui a été présidente de l’ATLF et qui travaillait déjà pour cette maison d’édition. Mais ils n’ont jamais eu conscience qu’il y avait eu quelqu’un d’autre.
J’avais fait la fiche de lecture et un petit essai de traduction. Puis je l’ai envoyé à droite et à gauche, et j’ai contacté l’agent de la maison d’édition, qui avait un agent à Paris. Quand je l’ai contactée, l’agente m’a dit de lui envoyer ma fiche de lecture et mon essai de traduction, et qu’elle relaierait auprès de l’éditeur qui achèterait le livre pour le traduire en français. J’étais trop contente. Je lui envoie tout ça, puis je n’ai plus aucune nouvelle. À l’été, le bouquin sort en français, traduit par quelqu’un d’autre. Et la quatrième de couverture, c’était ma fiche de lecture ! J’étais furax. Je m’étais fait embobiner par cette agente. J’ai appelé chez Anne Carrière, la maison d’édition française. Je demande : « C’est qui chez vous qui a écrit la quatrième de couverture ? » On me répond : « J’en sais rien, pourquoi ? » Je dis : « C’est moi qui l’ai écrite ! Reprenez le dossier. » Elle me dit : « Oui, j’ai un dossier, mais c’est l’agent qui me l’a fait parvenir, il y a son nom partout, votre nom n’apparaît nulle part. On n’a jamais su que vous existiez. Je suis absolument désolée. » L’agente littéraire avait enlevé mon nom partout et mis le sien. Elle ne l’a pas traduit, c’est quelqu’un d’autre qui l’a traduit, mais quand même. Après, je ne sais pas s’ils m’auraient confié le livre parce que j’étais une jeune traductrice. Ça a été très bien traduit d’ailleurs, par une traductrice qui a été présidente de l’ATLF et qui travaillait déjà pour cette maison d’édition. Mais ils n’ont jamais eu conscience qu’il y avait eu quelqu’un d’autre.– Lise : Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre « décor de traduction », le cadre dans lequel vous travaillez ? Parce que ce n’est pas seulement un métier intellectuel, en fait, c’est aussi un peu physique, on a souvent mal à la nuque, mal au dos... Est-ce que vous avez un bureau, un coin bureau ?
– Alexia : J’ai une super chaise où je suis très bien installée, mais dont j’ai cassé le dossier, il va falloir que j’en change. Je crois que j’ai toujours traduit avec cette chaise. C’est important en fait, ma chaise. Il faut qu’elle soit assez large pour que je tienne en tailleur. À côté, il y a le fauteuil du chat. Parce qu’il traduit avec moi toute la journée. Et j’ai une grande bibliothèque en mezzanine. Ce qui est hyper pratique, c’est aussi que j’ai une porte blindée, en fait. Aucun bruit ne passe. Ça matérialise bien mon domaine.
– Janique : Moi je suis un peu comme toi, je suis toujours assise n’importe comment, avec une seule jambe dessous, je ne sais pas tenir assise. Il est tout déglingué mon fauteuil aussi. Mais maintenant, j’ai un vrai grand bureau, qui fait douze mètres carrés, avec une grande fenêtre qui donne sur la cour. Avant, je travaillais dans ma véranda, où il n’y avait pas de chauffage. Il faisait quarante degrés l’été et treize l’hiver. Et c’était tout petit. Donc maintenant, j’ai un grand bureau avec des meubles que j’ai chinés. Ça fait très années cinquante. Il y a plein de place, un canapé. Parce que la véranda, c’était cinq mètres carrés, j’avais tout le temps l’impression d’être à l’étroit, j’étais coincée entre les toilettes et la cuisine. C’est comme ça que j’ai commencé à garder des chats. Avec mon ordi, je me suis dit que je pouvais aller travailler un peu partout. Et c’est vrai que j’avais tout le temps des grandes maisons pour moi toute seule. Pour le coup, c’était tranquille. Une fois, j’étais à Fontarrabie, avec vue sur la mer. Pareil à Édimbourg, j’étais chez une dame en hauteur avec vue sur l’eau, la plage. Maintenant, c’est vrai que je le fais moins parce que j’ai un grand bureau, de la place, un canapé pour le chat.
– Lise : Et quel est votre processus de travail, parce que tout le monde n’a pas le même. Vous avez plutôt tendance à faire un premier jet d’une traite pour avoir une première vision d’ensemble sur laquelle revenir ensuite, ou à faire dès le début une version relativement aboutie, petit à petit ?
– Alexia : Moi, je n’aime pas écrire quelque chose qui n’est pas proche de ce qui pourrait être définitif. En plus, avec l’allemand, il y a de gros décrochages. Si tu commences à écrire une version un peu trop littérale, tu risques de bloquer dessus et d’avoir du mal à t’en détacher, donc j’évite de l’écrire. À la limite, je le pense, mais je ne vais pas l’écrire. Disons que je ne suis pas réputée pour ma rapidité. Mais quand c’est fait, c’est fait. J’ai traduit de l’anglais cet été, et ce n’est pas pareil avec l’anglais. Mais avec l’allemand, tu dois toujours faire le deuil de tout un tas de choses présentes dans le texte source. C’est quelque chose qu’on acquiert avec l’expérience, et que j’avais plus de mal à faire lors de mes premières traductions. Les étudiants ont souvent ce problème. Il y a tellement de choses dans le texte source. On n’arrive pas à tout mettre dans le texte cible. Si tu commences à tout écrire, ça devient illisible. Il y a en particulier toutes ces petites prépositions, qui suggèrent que le soleil, il arrive par là, mais non, en fait l’eau remonte par là… Il y a une profusion de détails en allemand. Le français est une langue à contexte fort, et l’allemand une langue à contexte faible. Ça veut dire que, quand tu prends un texte allemand, tu as beaucoup moins de choses à aller chercher dans le contexte. Tout est dans le texte. En français, il y a des tas de choses qui ne sont pas dites, elles sont dans cet espace contextuel qu’on partage tous, parce qu’on parle la même langue, et ça, c’est une grosse différence.
– Lise : Donc quand tu passes au français, il y a des choses que tu enlèves un peu ?
– Alexia : Est-ce que tu les enlèves ? Je ne sais pas. Par exemple, est-ce que tu as besoin de préciser que tu te lèves toujours en faisant ce mouvement-là, comme on peut dire en allemand ? Quand tu te lèves, tu te lèves. Tu n’as pas besoin de te lever dans ce sens-là. Il s’agit juste de retrouver un peu de familiarité avec ta langue à toi et faire le deuil de ce que tu perds de la langue source.
– Janique : En anglais aussi, ils précisent tout le temps, par exemple look down, est-ce qu’il faut préciser à chaque fois qu’on regarde en bas ?
– Lise : Et puis ils haussent les épaules tout le temps en anglais.
– Janique : Oui, et puis ils remuent la tête. Qu’est-ce qu’ils ont tout le temps à hocher la tête ?
– Lise : Moi, des fois, j’en enlève.
– Alexia : Voilà, et quand tu arrives à faire ça sans te sentir traître, c’est un bon progrès, et surtout ça ne nuit pas du tout au texte cible. C’est ça, le principal, avoir assez d’assurance pour le faire, mais pas trop non plus.
– Lise : Ça, ça vient avec le temps. Et toi, Janique, est-ce que tu as tendance à faire un premier jet d’ensemble ou pas ?
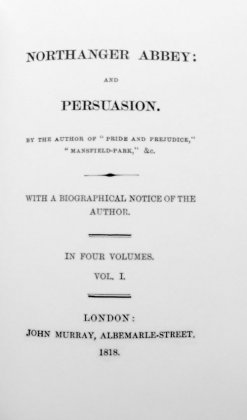 – Janique : Je fais un premier jet d’ensemble, mais j’essaie quand même qu’il soit à peu près bien. Et je relis petit à petit. Mettons que je fais un chapitre par jour, puis je le relis, je corrige tout ce qui peut être corrigé. Dernièrement, je suis passée d’une retraduction de Persuasion de Jane Austen à Jennifer Haigh. Avec Jane Austen, je relisais quatre fois au minimum chaque phrase, voire dix, pour arriver à comprendre ce qu’elle voulait dire. Je n’allais vraiment pas vite. Une fois que j’avais à peu près compris la phrase qui faisait près de trois quarts de page à chaque fois, avec ses dix-huit propositions, que j’avais remis ces dix-huit propositions dans le bon ordre en français… Je n’ai jamais été aussi lente. Il fallait que je travaille complètement différemment de d’habitude. J’étais obligée d’avoir vraiment quelque chose d’à peu près abouti dès le début. Et encore le lendemain, je relisais le chapitre traduit la veille et je me rendais compte que certaines phrases ne voulaient rien dire.
– Janique : Je fais un premier jet d’ensemble, mais j’essaie quand même qu’il soit à peu près bien. Et je relis petit à petit. Mettons que je fais un chapitre par jour, puis je le relis, je corrige tout ce qui peut être corrigé. Dernièrement, je suis passée d’une retraduction de Persuasion de Jane Austen à Jennifer Haigh. Avec Jane Austen, je relisais quatre fois au minimum chaque phrase, voire dix, pour arriver à comprendre ce qu’elle voulait dire. Je n’allais vraiment pas vite. Une fois que j’avais à peu près compris la phrase qui faisait près de trois quarts de page à chaque fois, avec ses dix-huit propositions, que j’avais remis ces dix-huit propositions dans le bon ordre en français… Je n’ai jamais été aussi lente. Il fallait que je travaille complètement différemment de d’habitude. J’étais obligée d’avoir vraiment quelque chose d’à peu près abouti dès le début. Et encore le lendemain, je relisais le chapitre traduit la veille et je me rendais compte que certaines phrases ne voulaient rien dire. Mais sinon, en général, je traduis et je relis chapitre par chapitre, en essayant que ça soit à peu près bien. Mais ensuite, je relis encore beaucoup, entre six et huit fois. Jusqu’à ce que je sois satisfaite. C’est comme Carver qui disait qu’il relisait ses nouvelles jusqu’à ce qu’il remette les virgules à la même place. Jusqu’à ce qu’il n’ait plus besoin de rien bouger, en fait. Je relis jusqu’à ce que je n’aie plus rien à changer. Pendant le premier jet, je travaille beaucoup. Dix, onze heures par jour. Je m’arrête à midi, je mange un truc vite fait et je recommence. Par contre, quand je relis, je ne peux pas travailler autant. Si tu relis pendant dix heures, tu ne vois plus rien au bout d’un moment. En général, je fais une relecture complète. Puis je passe le fichier dans Antidote pour voir les répétitions. Tu crois que tu as éliminé toutes les répétitions, mais quand tu le passes dans Antidote, il y en a partout.
– Alexia : Moi, je n’utilise pas Antidote, je fais ma correction avec Word. Pour la relecture, j’utilise un truc appris au Goldschmidt : quand j’ai commencé ce programme, je savais traduire, globalement, je n’y ai pas appris à traduire. J’ai appris à lire. Ce qu’on faisait souvent, c’était relire à haute voix.
– Janique : Je le fais tout le temps, je relis toujours à haute voix, surtout pour les dialogues, pour que ça sonne bien. Si ça accroche sur un mot c’est que ça ne va pas, il faut changer. Persuasion, je l’ai lu deux fois à haute voix. Je crois que n’ai jamais autant bossé sur une traduction. C’est assez court, trois cents feuillets, mais j’ai quand même mis quatre mois.
– Lise : Oui, enfin, trois cents feuillets, ce n’est pas rien, et puis Jane Austen c’est quand même un monument. C’est intimidant aussi.
– Janique : C’est ça, parce que quand Gallmeister me l’a proposé, j’étais là : « Non mais ça va pas ? T’es sûr, Oliver ? » Il m’a dit oui, oui. J’ai dit : « Je vais te faire un essai. Et puis je vais le relire déjà, en anglais. »
– Lise : Est-ce que tu as comparé avec les autres traductions existantes ?
– Janique : Non, enfin si, j’en ai une à la maison. C’est une traduction de 1945 qui est un peu lourde, mais quand même, de temps en temps, je regardais pour voir si j’avais bien compris, si le traducteur avait compris comme moi la phrase. Mais je ne voulais surtout pas voir les autres. Parce que je sais qu’il y en a une à la Pléiade, quand même. Et je me disais, mais pourquoi Gallmeister veut qu’on refasse ça ?
– Lise : Mais ça te plaisait quand même ?
– Janique : Le défi, oui, parce que j’avais lu Jane Austen, et j’aime bien ça. Mais c’était un sacré défi quand même : je n’ai pas fait d’études d’anglais, je ne suis pas spécialiste de l’Angleterre, beaucoup plus des États-Unis. Pas du tout du dix-neuvième. Enfin… je ne suis spécialiste de rien. Chaque fois que tu lis les biographies des gens qui ont traduit, c’est genre des spécialistes de la littérature victorienne, moi je ne suis spécialiste de rien. Bon, finalement, ils ont été ravis de ma traduction. Inès Gallmeister, qui l’a entièrement relue, ne m’a renvoyé que très peu de corrections.
– Alexia : Chez les germanistes, le monument, c’est Kafka. Dans un texte, dès qu’il y a la moindre référence à Kafka, je ne sais pas pourquoi, ça me terrorise. Traduire un auteur comme ça, c’est particulièrement une traduction sous contraintes… Vous avez vu le thème des prochaines Assises d’Arles en 2025, d’ailleurs ? « La traduction sous contraintes ». Va traduire La Disparition de Perec !
– Lise : Est-ce que vous n’avez pas l’impression que traduire, justement, c’est un peu écrire sous contraintes ?
– Alexia : J’ai toujours du mal avec ce « écrire » parce que tu n’as pas cette part de création, d’invention du monde dans la traduction. Il y a une part d’écriture, certes, mais il ne s’agit pas encore de cette chose-là : faire tenir un monde ensemble. J’ai fait un atelier d’écriture aux dernières Assises à Arles. Il fallait imaginer un être organique, mais qui n’était pas humain. En imaginant son point de vue. Ça, c’est bien comme contrainte, ça te permet de te lancer. Tu peux écrire un peu. C’est tout ce travail d’imagination que tu n’as pas à faire quand tu traduis.
– Janique : Voilà, c’est ça, moi j’ai du mal à imaginer. Quand j’étais jeune, j’avais plein d’idées, j’écrivais des nouvelles tout le temps, j’ai des dizaines de nouvelles à la maison. J’ai écrit des romans que je n’ai jamais relus. Ils étaient dans un tiroir, je les ai retrouvés en déménageant. Quand j’étais petite, si on me demandait ce que je voulais faire, je disais « je veux être écrivain ». Après, j’aime bien écrire, mais traduire c’est plus rigolo, tu passes d’un style à l’autre.
– Lise : C’est rassurant en effet de ne pas avoir tout à inventer, de n’avoir « que » les mots à trouver, mais finalement ça fait beaucoup, tous les mots à trouver !
– Janique : Quand on passe de Jane Austen, qui est quand même début dix-neuvième, avec ses imparfaits du subjonctif, à Jennifer Haigh, aujourd’hui à Shanghai, ce n’est pas du tout la même langue. Alors là, du coup, Jennifer, ça me paraît super facile. Je comprends toutes les phrases, je comprends tous les mots. J’ai un peu de mal avec l’univers chinois, mais je n’ai pas besoin de relire quatre fois chaque phrase. Et puis elle écrit beaucoup avec des phrases courtes et incisives. Alors qu’avec Jane Austen, les phrases sont super longues et il faut quand même que ça reste fluide.
– Lise : Il y a une dernière question que je voulais vous poser, parce que c’est aussi par le biais de Matrana qu’on se connaît. Pour moi, c’est important, la vie associative, le fait de pouvoir se rencontrer entre traducteurs et traductrices, puisque c’est un métier quand même assez solitaire. Est-ce que ça joue un rôle important dans votre métier ?
– Alexia : Tu sais le dernier « café Matrana », quand cette copine est venue ? C’est une fille qui traduit depuis hyper longtemps. Nous, on était tous de Matrana, et les bonnes choses, tu t’y habitues tellement vite que tu ne t’aperçois pas à quel point c’est bien. C’est plus difficile quand tu n’as pas ce réseau. Juste parfois pour te décharger de tes angoisses avec un éditeur qui te fait des misères, et c’est ce qui lui arrive à cette copine. Elle a pourtant beaucoup publié, mais elle n’arrive toujours pas à négocier avec son éditeur, et elle était contente de pouvoir échanger là-dessus.

– Janique : Moi c’est vrai que j’ai débarqué dans ce milieu complètement… à cinquante ans, sans connaître personne. C’est quand même sympa de rencontrer des gens. D’abord, j’ai été à une joute de traduction organisée par Matrana. Et après j’ai fini par m’inscrire. Après, chez Gallmeister, ce qui est bien c’est qu’on n’est pas complètement isolé, il y a beaucoup d’auteurs en tournée tout le temps. Donc on se connaît tous, on connaît les auteurs, ils sont toujours en train de nous présenter les uns aux autres.
– Lise : La traduction est plutôt un métier solitaire, est-ce que vous, ça vous pèse ou pas du tout ?
– Alexia : Ah non, moi ça ne me pèse pas du tout.
– Janique : Moi, j’adore être toute seule ! Travailler toute seule. J’ai horreur de travailler avec des gens.
– Alexia : Moi, si je pouvais en vivre, je ne ferais que ça.
– Lise : Moi, j’aime bien l’équilibre entre être la plupart du temps toute seule, et de temps en temps participer à des rencontres associatives, aller à un festival. Pas trop, mais un peu quand même.
– Alexia : Juste pour que tu trouves ça bien. Et puis dès que tu commences à en avoir marre, tu retournes à ton travail !

