Propos recueillis le vendredi 13 décembre 2024
Certains vendredis treize se déroulent très bien : cette après-midi-là de décembre, nous nous sommes retrouvées avec Janique Jouin et Alexia Valembois, confortablement installées devant la cheminée d’Alexia, avec des cookies confectionnés par Janique, pour une interview à bâtons rompus sur notre métier commun de traductrice littéraire. Des Ramones à Jane Austen, de Berlin à Shanghai et de L’Attrape-cœurs aux Annales du Disque-monde, la traduction n’est pas un long fleuve tranquille – c’est même parfois un sport de combat.
– Lise : Quels souvenirs gardez-vous de votre première traduction ?
– Janique : Ma première traduction, c’était pour mon mari Nicolas. On était à New York, on venait juste de se rencontrer, et je l’avais emmené là-bas fêter ses trente ans. Je lui ai offert une biographie des Ramones, son groupe préféré. Je ne connaissais pas trop son niveau d’anglais, mais il m’a dit qu’il ne comprenait rien, et il m’a demandé si je ne pouvais pas le lui traduire. Donc c’est ce que j’ai fait. Je bossais la journée, mais le soir, je traduisais. Ce n’était pas très bien traduit, j’allais un peu vite, parce qu’il était pressé de lire. Tous les soirs, je lui traduisais un chapitre, je l’imprimais, je lui posais sur sa table de nuit et le lendemain, il avait son chapitre. Et j’ai trouvé ça génial. Mais ce n’était que pour lui, personne d’autre ne l’a lue à part son frère, je crois.
– Lise : Donc tu n’étais pas encore traductrice ?
– Janique : Pas du tout. À ce moment-là, je faisais des sondages. Mais, en plus de mon boulot, je faisais plein de trucs dans la musique : dans des assos, j’organisais des concerts, j’écrivais dans des fanzines. Quelques années plus tard, une biographie des Fleshtones a été publiée, et c’était mon groupe préféré. Alors j’ai voulu la traduire. Mais c’était long, et je travaillais, donc je crois que j’ai mis quatre ans pour terminer. Mais cette fois-ci, je me suis dit que j’allais m’appliquer et essayer de la proposer à quelqu’un. Elle a été publiée chez Camion blanc. J’en ai d’ailleurs fait une deuxième pour eux, sur les Ramones, écrite par le frère de Joey Ramone. Mais il n’y avait pas grand monde pour relire chez Camion blanc, il n’y avait même pas vraiment d’éditeur. En fait, ils ne paient pas les traducteurs, ce ne sont que des bouquins sur la musique tirés à trois cents exemplaires. La plupart des gens qui traduisent pour eux ne sont même pas traducteurs, et la plupart des bouquins qui sortent chez eux sont illisibles. Mais au moins, cette expérience m’a permis de faire le master de traduction en passant par une validation des acquis professionnels, parce que je n’avais pas de diplôme d’anglais, mais avec des traductions publiées, j’ai pu postuler.
– Alexia : Et d’où venait ton super niveau d’anglais ?
– Janique : J’ai toujours aimé l’anglais, et j’avais un bon niveau au lycée. À la fac, je ne savais pas trop quoi prendre, alors je m’étais inscrite en anglais et en psycho. Mais finalement je n’ai pas trop aimé l’anglais, parce qu’il n’y avait rien sur les États-Unis, et c’était la seule chose qui m’intéressait. Et puis à l’époque, en 1981, à part être prof, on ne proposait aucun autre débouché. Et je ne voulais absolument pas être prof. Donc j’ai laissé tomber et j’ai fait de la psychologie sociale, en me disant que j’aurais plus d’opportunités. Mais je n’ai pas trop trouvé de travail et je n’ai pas trop cherché non plus : la musique m’amusait beaucoup plus, je trouvais ça plus rigolo de manager des groupes. Mais j’adorais l’anglais et puis j’organisais des concerts, j’avais tout le temps des groupes américains ou anglais chez moi. Donc il fallait bien que je parle anglais, et je voulais vraiment pouvoir discuter avec eux. Alors j’ai beaucoup travaillé toute seule, j’avais encore les livres de la fac et je faisais des exercices, de la grammaire. Je lisais le dictionnaire… Et puis j’allais quand même souvent en Angleterre, puis aux États-Unis. J’achetais des bouquins, je lisais la presse musicale anglaise. Enfin bref, j’ai toujours aimé ça, l’anglais.
– Lise : Et toi, Alexia, ta première traduction ?
– Alexia : D’abord, j’ai fait un premier essai en faisant le programme Goldschmidt franco-allemand. C’est un échange entre traducteurs littéraires du français et de l’allemand. Moi, mon parcours était plus classique, j’avais fait le master de traduction ici, à Bordeaux, en allemand. Et au départ, j’avais aussi fait une licence d’anglais en pensant que ça me serait plus utile. Mais c’était mon premier amour, l’allemand. J’adore cette langue, c’est une langue qui parle à mon esprit. J’ai l’impression d’être éveillée quand j’entends parler allemand. Donc j’ai voulu faire ce master de traduction pour avoir quelque chose qui atteste de mon niveau d’allemand. Puis j’ai demandé cette bourse Goldschmidt. Et ça a été le pur bonheur. Ils prenaient cinq Allemands et cinq Français chaque année. On était peu nombreux et on rencontrait des agents littéraires, des éditeurs, et j’ai choisi une auteure que j’ai commencé à traduire. Le livre s’appelait Das Wasser, in dem wir schlafen, ce qui veut dire littéralement « l’eau dans laquelle nous dormons ». C’était une histoire un peu glauque, mais le livre était hyper intéressant. Une partie du programme se déroulait à Arles, et j’en avais discuté avec une éditrice d’Actes Sud qui lisait l’allemand. Elle m’avait dit que quelque chose la gênait chez cette auteure. Elle pensait qu’il y avait une trop grosse part autobiographique dans ce roman pour que ce soit véritablement une écrivaine et qu’elle ait réellement une carrière littéraire. Et elle n’a pas eu complètement tort parce que le livre n’a jamais été acheté par un éditeur français. Et l'auteure a mis des années à écrire son second bouquin, qui était encore plus glauque que le premier, et qui n’a jamais été acheté non plus. C’est dommage car il y avait un truc très prometteur dans ce premier roman, cette poésie glauque. Donc ça a été ma première traduction, mais je n’ai traduit que les cent premières pages pendant le programme Goldschmidt.
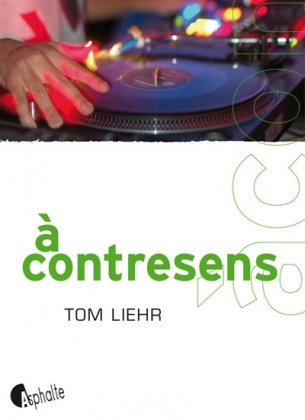 Et à la fin du programme, Claire Duvivier des éditions Asphalte, qui avait un projet de traduction de l’allemand, a proposé à notre promotion de faire un essai sur son projet. Pendant le programme, on travaillait en binôme, une Française et une Allemande, et on s’entendait assez bien. Et c’est notre essai qui a été retenu, et notre traduction a finalement été publiée. Pour un roman allemand, ça a plutôt pas mal marché d’ailleurs. Cette expérience m’a vraiment convaincue que c’était le bon choix, que cette activité me plaisait. Parce qu’en fait j’avais toujours traduit avant : je travaillais dans le jeu vidéo. Mais là, c’était ma première traduction littéraire. Travailler pendant des mois sur un même texte, c’est très différent des studios, où on est toujours dans l’urgence. Et c’est l’époque où ma fille est née, je me suis dit que ce n’était plus possible de travailler comme ça.
Et à la fin du programme, Claire Duvivier des éditions Asphalte, qui avait un projet de traduction de l’allemand, a proposé à notre promotion de faire un essai sur son projet. Pendant le programme, on travaillait en binôme, une Française et une Allemande, et on s’entendait assez bien. Et c’est notre essai qui a été retenu, et notre traduction a finalement été publiée. Pour un roman allemand, ça a plutôt pas mal marché d’ailleurs. Cette expérience m’a vraiment convaincue que c’était le bon choix, que cette activité me plaisait. Parce qu’en fait j’avais toujours traduit avant : je travaillais dans le jeu vidéo. Mais là, c’était ma première traduction littéraire. Travailler pendant des mois sur un même texte, c’est très différent des studios, où on est toujours dans l’urgence. Et c’est l’époque où ma fille est née, je me suis dit que ce n’était plus possible de travailler comme ça.
– Lise : Quel serait votre meilleur souvenir et/ou votre pire souvenir de traduction ? Y a-t-il une traduction qui vous a vraiment marquées, que vous avez vécue comme un vrai plaisir, ou au contraire comme une expérience douloureuse, que ce soit à cause du texte lui-même ou parce que les conditions de travail étaient mauvaises, les délais trop serrés par exemple, ou la communication avec l’éditeur compliquée ?
– Alexia : Moi, je traduis encore, souvent, pour un packageur. À chaque fois, je me dis que je ne le ferai plus, mais je continue parce qu’ils me proposent toujours du travail. À force, on a réussi à normaliser nos relations. Mais au début, l’éditrice qui s’en occupe donnait des délais extrêmement serrés. J’essayais de grappiller une semaine, quinze jours, mais c’était rarement plus. Et puis cinq ou six jours avant la date de remise, elle commençait à me harceler au téléphone pour me demander où j’en étais. Un stress horrible ! Parfois, j’ai demandé à des copines de traduire avec moi, mais elles sont devenues folles. Maintenant, ça va mieux. À un moment donné, on était deux ou trois sur un livre, une énorme biographie de Lara Croft. Je trouvais ça stimulant de faire la biographie d’un personnage de fiction, et comme elle existe depuis longtemps, il y avait de la matière. J’avais toute la partie sur les comics, c’était super intéressant. Mais alors les conditions ! À chaque fois on me demande pourquoi je retravaille avec eux. C’est parce qu’ils ont tout le temps des projets. Mais maintenant je suis devenue plus ferme. Je ne démarre la traduction qu’après avoir reçu le premier acompte, parce que des fois, j’ai vraiment été en difficulté : l’éditrice me devait quatre mille euros mais elle traînait, et c’était d’un stress ! Et le travail t’occupe tellement que tu n’as le temps de rien faire d’autre à côté. Et pendant trois mois, il faut travailler sans argent ! Il fallait être à la fois assez calme pour pouvoir traduire paisiblement, tout en gérant le fait de ne pas avoir une seule thune. J’en étais à éviter de passer devant la banque. Il y a vraiment des moments comme ça.
– Lise : C’est ça aussi la traduction pour beaucoup d’entre nous. Il y a souvent un côté précaire : on n’est pas toujours payé dans les temps, on ne sait pas si on va nous redonner du travail...
– Alexia : Moi, ça m’aide à avoir l’esprit tranquille, la traduction, mais j’ai besoin d’avoir l’esprit tranquille aussi pour traduire. Dès que j’ai des pensées parasites qui m’assaillent, le boulot devient horrible. J’ai besoin d’avoir un peu de stabilité.
– Lise : Et toi, Janique ?
– Janique : Moi, je parlerai plutôt de mon meilleur souvenir : ma première traduction littéraire pour Gallmeister. En fait, je rêvais de travailler pour eux, mais ça me paraissait improbable. Tout le monde me disait que ce n’était pas possible. J’ai rencontré Oliver Gallmeister à Lyon, au festival Quais du polar. J’ai été le voir et on a discuté une bonne demi-heure. Et il m’a dit que la maison embauchait rarement, et qu’ils travaillaient toujours avec les mêmes traducteurs. « Mais bon, envoyez votre CV. » Et deux ou trois mois après, ils m’ont appelée pour me proposer une traduction.
– Lise : En ayant juste envoyé ton CV ?
– Janique : On avait beaucoup discuté. Et puis c’est vrai qu’on a à peu près le même âge, même s’il est un peu plus jeune que moi, on aime les mêmes choses. À l’époque ils avaient des auteurs peu connus, par exemple Jake Hinkson. Et justement, je l’avais lu en anglais. Oliver n’y croyait pas, c’était un auteur très peu connu – aux USA, il n’avait vendu que deux cents exemplaires. Donc évidemment, ce genre de choses, ça joue, et puis je connaissais bien la maison d’édition. Donc, d’abord, ils m’ont appelée et ils m’ont fait faire un essai. J’étais super contente. Je me rappellerai toujours ce moment. J’étais en train de faire des courses, je décroche mon téléphone et je n’en crois pas mes oreilles. On partait à New York quinze jours après. Ils m’ont dit que j’avais quinze jours pour traduire je ne sais plus combien de pages, les trois premiers chapitres, je crois. Le stress ! Je fais l’essai, je l’envoie trois jours avant de partir à New York. Et en fait, le lendemain, ils m’ont téléphoné et ils m’ont dit : « C’est bon, vous avez le bouquin. On vous envoie le contrat. Vous partez à New York et vous commencerez la traduction en rentrant. » Et donc voilà, c’était la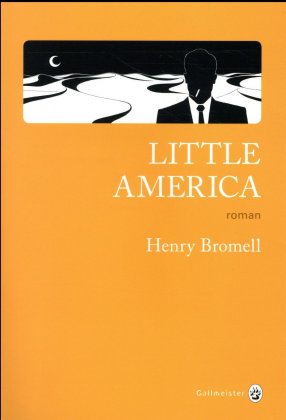 première fois de ma vie qu’il me tardait de rentrer de vacances.
première fois de ma vie qu’il me tardait de rentrer de vacances.
Quand je m’y suis mise, je travaillais toute la journée, jusqu’à onze heures du soir. J’étais surexcitée, en fait. Maintenant j’ai des horaires un peu plus calmes. Je ne sortais même plus de chez moi : à un moment donné, je me suis aperçue que je n’étais pas sortie depuis quinze jours tellement j’étais passionnée par ce que je faisais. C’était la première fois que je traduisais de la littérature, et c’était un truc qui me paraissait complètement improbable. J’y pensais déjà quand j’étais ado. J’aurais bien voulu faire ça, mais ça me paraissait impossible.
– Lise : Ah, tu y pensais déjà si jeune ?
– Janique : Oui, je lisais beaucoup de littérature américaine, mais je pensais que c’était un boulot impossible et que les traducteurs, ce n’étaient que des gens nés avec les deux langues. Ado, j’ai lu Catcher in the Rye [L’Attrape-cœurs] en français. Je l’ai lu deux fois de suite, mais je trouvais que certaines choses ne collaient pas. Donc je suis allée en librairie, et je l’ai commandé en anglais. C’est la première fois que je lisais un livre en anglais. Et quand j’ai lu la version originale, forcément j’ai trouvé ça génial. Je l’ai lu deux fois d’affilée. Et c’est là que je me suis dit : la traduction, du coup, c’est impossible. Il y avait tellement de différence entre la version américaine et la traduction. J’avais la première traduction – il y en a trois, mais je n’ai jamais lu la troisième. J’ai acheté la deuxième quand elle est sortie quelques années plus tard, et je n’étais toujours pas satisfaite. Je voyais l’écart entre l’original et la traduction. Et donc pour moi, c’était impossible. Donc j’ai laissé tomber cette idée.
– Lise : Mais pourquoi ça te paraissait impossible ? Ça te paraissait impossible de faire une bonne traduction ?
– Janique : Oui, je me disais que c’était extrêmement compliqué. D’autant plus que le livre n'était compliqué, en apparence. C’était le premier livre que je lisais en anglais, et ça ne me paraissait pas si difficile… C’est d’ailleurs pour ça que c’est très compliqué à traduire justement. Mais à l’époque, je ne me posais pas ce genre de questions. Après, je me suis amusée à traduire des choses dans le fanzine Abus dangereux, je traduisais toutes les interviews, même celles des autres, parce que j’étais une des seules qui maîtrisait un peu l’anglais. Mais je n’avais pas l’intention de faire de la traduction, je traduisais des articles, point final.
– Alexia : Moi, avant de me mettre à la traduction, dans une autre vie, j’habitais en Angleterre. J’avais un petit ami irlandais. Et le soir, je me souviens, il me lisait des livres en anglais : on a commencé avec Terry Pratchett, Les Annales du Disque-monde. C’est sorti chez l’Atalante depuis. Quand il me lisait l’anglais, il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas. C’est un monde complètement imaginaire avec des appareils photo et des petits nains dedans qui peignent… Lui, il était mort de rire. Et chaque fois je l’arrêtais pour qu’il m’explique les blagues et je me disais mais comment ça se traduit, ce genre de trucs ? On a lu aussi Hitchhike to the Galaxy (Le Guide du voyageur galactique en français) et c’est pareil, ce sont des blagues tellement anglaises ! Mon copain passait vingt minutes à m’expliquer une blague, elle était moins drôle au final, mais au moins j’avais compris. Et moi aussi, je m’étais dit : mais c’est impossible de traduire ça, à moins de faire une explication de texte sur dix pages ! À l’époque, j’étais à la fac en Angleterre et je m’étais inscrite pour passer les concours de journalisme. Et puis, pour diverses raisons, ça ne s’est pas fait, mais je crois que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser à la traduction. Depuis le début, j’adore ça, l’humour, mais je trouve que c’est une des grosses difficultés dans la traduction. Dans le premier bouquin que j’ai traduit, il y avait tout un passage que je trouvais très drôle. Moi, la traduction me paraissait drôle, mais l’éditrice me disait qu’en français, ça ne fonctionnait pas du tout. J’avais traduit beaucoup trop littéralement.
– Lise : Alors toi, Janique, tu m’as donné ton meilleur souvenir, et toi, Alexia, le pire, mais ton premier roman chez Asphalte, c’était une bonne expérience, non ?
– Alexia : J’ai adoré travailler sur les deux livres que j’ai traduits pour Asphalte, c’étaient vraiment des bouquins intéressants. Et puis il y avait un vrai travail d’édition. C’est aussi parce que ça s’est bien passé avec eux, en fait. C’est important, le rapport avec l’éditeur, le correcteur : tu as réellement l’impression d’un travail d’équipe. Pour moi, c’est toujours une grosse angoisse de me dire qu’il n’y a que moi qui ai vu le texte. J’adore quand il y a d’autres gens. J’aimerais avoir toujours des gens qui relisent vraiment en détail, mais ce n’est pas toujours le cas, selon les personnes avec qui tu travailles.
– Janique : Chez Gallmeister, ils relisent vraiment. Ils ont des correcteurs employés en interne et leur travail est toujours ultra pertinent. Tu peux discuter, mais quand ils corrigent quelque chose, ce n’est pas pour t’embêter, c’est qu’ils ne laissent rien passer. À la fin, tu sais que plein de gens auront relu ta traduction et que tu vas sortir quelque chose de bien. Parfois on se plante, on loupe une phrase… Et alors justement, du coup, mon pire souvenir, c’était une traduction pour Le Castor astral. Ils m’avaient demandé de traduire une biographie de Manu Chao écrite par un Anglais. J’étais très copine avec Manu Chao, je le connais depuis ses débuts avec les Hot Pants puis avec la Mano Negra. Je les ai vus trente-quatre fois en concert. J’étais tout le temps avec eux à l’époque – maintenant ça fait 25 ans que je ne l’ai pas revu. Donc j’accepte en me disant que ça allait être sympa, et que ça irait vite. Alors je commence à traduire, mais très vite je m’aperçois qu’il y a plein d’erreurs, de noms, de dates. Et il y avait énormément de citations : l'auteur avait repris plein d’articles, d’extraits de livres et de films qu’il avait traduits lui-même en anglais depuis le français. Et à la fin, pas de bibliographie, pas de références. Je lui envoie un message, en lui disant qu’il faut que je retrouve les sources. Toutes les sources étaient françaises, ça venait de Rock & folk, tout ça. Il me dit qu’il a tout jeté, que son éditeur lui avait dit que ça ne servait à rien de tout garder. Moi, j’avais quand même mes propres ressources à la maison, et j’avais gardé tout ce qui était sur la Mano. J’ai récupéré tous les livres et les films qu’il me manquait à la bibliothèque. J’ai retranscrit les films mot à mot. Heureusement, je donnais des cours à la fac cette année-là donc j’avais aussi accès à toutes les publications en ligne. Je faisais des recherches avec des mots-clés. Ça m’a pris un temps fou et je n’ai pas tout retrouvé, peut-être 80 %. C’était bourré d’erreurs et puis c’était mal traduit depuis le français. Donc, j’avais parfois du mal à retrouver la phrase originelle. Moi qui pensais que ce serait simple…
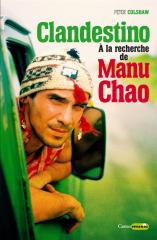 Heureusement, je connaissais leur vie par cœur, et j’étais quand même encore en contact avec les membres du groupe, donc je pouvais leur poser des questions. Finalement, je lui ai corrigé tout son livre et je me suis dit, heureusement que c’est moi qui l’ai fait. En français, au moins, il est sorti sans erreurs. Je l’ai fait relire en entier par Jako, qui était leur tour manager, mais parfois l’auteur décrivait des scènes auxquelles j’avais assisté... C’était un travail de titan, et les éditeurs étaient des potes, donc je ne pouvais pas laisser passer. Le livre a été traduit dans plein de pays et je pense qu’ailleurs, les gens n’ont rien corrigé. Mais en France, beaucoup de gens connaissaient, je ne pouvais pas laisser passer des erreurs comme ça. Donc du coup, ça s’est un peu transformé en cauchemar. Le livre n’était pas long, mais je passais mes week-ends à retranscrire les vidéos…
Heureusement, je connaissais leur vie par cœur, et j’étais quand même encore en contact avec les membres du groupe, donc je pouvais leur poser des questions. Finalement, je lui ai corrigé tout son livre et je me suis dit, heureusement que c’est moi qui l’ai fait. En français, au moins, il est sorti sans erreurs. Je l’ai fait relire en entier par Jako, qui était leur tour manager, mais parfois l’auteur décrivait des scènes auxquelles j’avais assisté... C’était un travail de titan, et les éditeurs étaient des potes, donc je ne pouvais pas laisser passer. Le livre a été traduit dans plein de pays et je pense qu’ailleurs, les gens n’ont rien corrigé. Mais en France, beaucoup de gens connaissaient, je ne pouvais pas laisser passer des erreurs comme ça. Donc du coup, ça s’est un peu transformé en cauchemar. Le livre n’était pas long, mais je passais mes week-ends à retranscrire les vidéos…
– Alexia : Vous connaissez ce concept de disruption of credibility ? J’en avais discuté avec un éditeur de science-fiction. C’est hyper important ces petits détails pour rentrer dans l’univers d’un livre. Plus cet univers est éloigné du nôtre, plus il faut que ton lecteur te croie, qu’il se plonge avec toi dans cet univers, et si tu fais des petites erreurs comme ça, tu lui enlèves ce plongeon, le lecteur se rétracte et là, tu le perds. C’est aussi un peu la même chose en traduction : quand tu as super confiance en ton auteur, tu traduis beaucoup plus facilement. Parce que tout ce qui te paraît étrange, ce n’est pas pour rien. Et quand tu commences à avoir des doutes sur la fiabilité de ton auteur, au bout d’un moment, tu ne sais plus si c’est toi ou si c’est lui qui…
– Janique : Oui, ça m’est arrivé avec un autre auteur. Il y avait des erreurs : par exemple, l’histoire se passait dans les années 1950 et il y avait un personnage qui prenait du Valium, alors qu’à l’époque ça n’existait pas. L’auteur était paniqué quand je le lui ai dit, le pauvre. À la fin, je trouvais des solutions toute seule parce que sinon je le faisais trop paniquer. Dans un autre livre, on avait laissé une autre erreur, sur la date de naissance d’un mec, et c’est ma frangine qui l’a vue, mais c’était trop tard. Il était censé avoir fait la guerre du Vietnam, mais il était né en 1969 ! Mais il y en avait tellement que ça nous avait échappé.
– Alexia : Parfois, on ne repère pas l’erreur d’emblée, mais ça crée un malaise. Ton cerveau repère une incohérence, mais tu ne sais pas forcément laquelle. Pour ma première traduction, j’étais mal à l’aise avec les temps. J’en avais discuté avec ma tutrice du programme Goldschmidt et elle aussi, elle s’est mise à se plonger dans mon bouquin. Je me souviens, un soir on était toutes les deux, et elle me dit : ça y est, je sais ! Ça fait onze mois qu’elle est enceinte, la nana ! C’est ça qui nous mettait mal à l’aise. Mais c’était un peu trop vague, il fallait vraiment chercher pour retrouver. Elle était tombée enceinte en septembre, mais en juillet, le bébé n’était toujours pas là. Je n’avais pas repéré l’erreur, mais j’avais ce sentiment de malaise.
– Janique : Maintenant, chez les éditeurs américains, ils ne relisent plus, ils laissent passer beaucoup de choses. Et c’est vrai que, chez certains auteurs, on passe un peu notre temps à corriger.
– Alexia : C’est dingue en fait de se dire qu’une traduction, c’est parfois plus rigoureux. Vous avez lu le livre d’Umberto Eco, Dire presque la même chose ? Je crois que c’est là-dedans qu’il parle de ses traducteurs comme de ses lecteurs les plus attentifs.

– Lise : Et vous, est-ce que vous dialoguez souvent avec vos auteurs ? Ou trouvez-vous que ce n’est pas forcément utile ?
– Janique : Alors moi, ces derniers temps, j’ai fait beaucoup de classiques. Jane Austen, j’aurais bien voulu lui poser des questions parfois, ça m’aurait bien aidée !
– Alexia : Moi, pour les deux romans parus chez Asphalte, c’étaient des contemporains, et pour le premier, l’éditeur avait organisé une tournée de lecture à Paris. Donc on s’est rencontrés. L’auteur est berlinois, et il y avait des mots qui n’existent pas par ailleurs en allemand. Il n’y a pas vraiment de dictionnaires, et parfois je me demandais ce qu’il voulait dire, je ne trouvais ça nulle part. Il a pu m’expliquer des choses, et il m’a même fait des dessins. J’ai le même souci avec mes étudiants en allemand : pour certains textes qui comportent des régionalismes, je suis obligée de leur mimer les choses.
– Janique : J'ai traduit un Canadien auquel j’ai envoyé toute une liste de questions parce que je ne comprenais rien, je ne trouvais les mots nulle part. À l’époque j’avais des copines anglaises à Bordeaux à qui je pouvais demander, mais elles non plus ne comprenaient rien. L’auteur m’a répondu que c’était de l’argot canadien, de la campagne. Heureusement, on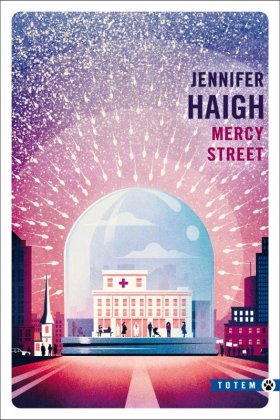 pouvait s’envoyer des messages. Avec Jennifer Haigh, c’est pareil, je lui envoie des messages, et en plus elle parle français couramment. La dernière fois, il y avait des jeux de mots dans un paragraphe, et j’ai dû tout changer, parce que c’était impossible de traduire sans perdre l’esprit du truc. Donc je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je change, mais on se connaît bien. En fait souvent, je me rends compte que les trucs que je ne comprends pas, c’est parce qu’il y a des erreurs. Et j’envoie souvent des messages pour le dire aux auteurs. Elliot Ackerman, c’est pareil, la dernière fois, je me suis rendu compte que je n’avais pas le bon fichier. Sa maison d’édition s’était trompée en envoyant un fichier non corrigé, avec plein d’erreurs. Donc, moi, je m’étais embêtée à relever plein d’erreurs qui, dans la version finale, avaient déjà été corrigées, enfin, pour la plupart…
pouvait s’envoyer des messages. Avec Jennifer Haigh, c’est pareil, je lui envoie des messages, et en plus elle parle français couramment. La dernière fois, il y avait des jeux de mots dans un paragraphe, et j’ai dû tout changer, parce que c’était impossible de traduire sans perdre l’esprit du truc. Donc je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je change, mais on se connaît bien. En fait souvent, je me rends compte que les trucs que je ne comprends pas, c’est parce qu’il y a des erreurs. Et j’envoie souvent des messages pour le dire aux auteurs. Elliot Ackerman, c’est pareil, la dernière fois, je me suis rendu compte que je n’avais pas le bon fichier. Sa maison d’édition s’était trompée en envoyant un fichier non corrigé, avec plein d’erreurs. Donc, moi, je m’étais embêtée à relever plein d’erreurs qui, dans la version finale, avaient déjà été corrigées, enfin, pour la plupart…
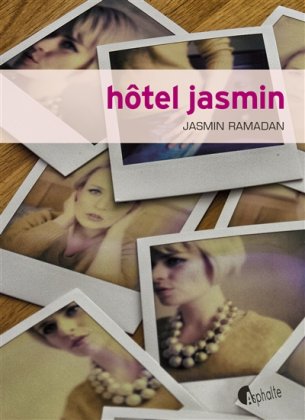 – Alexia : La deuxième autrice que j’ai traduite, je ne l’ai pas trop sollicitée pendant la traduction elle-même. Des fois, j’avais besoin de précisions, mais ce n’était pas grand-chose. Mais avant de commencer le bouquin, j’ai demandé une bourse mobilité à ALCA pour me rendre sur place. Ça se passait à Hambourg et j’y étais allée une fois, mais seulement un week-end et je ne connaissais pas du tout la ville. Or la ville jouait un rôle central dans le livre, surtout un quartier en particulier de Hambourg que je n’avais jamais vu de ma vie. Du coup, j’ai eu cette bourse et avec l’autrice, on s’est donné rendez-vous dans le quartier où ça se passait, et c’était super sympa. C’était un quartier hyper alternatif. C’était vraiment nécessaire de s’imprégner des lieux avant de commencer le travail. Et ça m’a bien aidée pour traduire.
– Alexia : La deuxième autrice que j’ai traduite, je ne l’ai pas trop sollicitée pendant la traduction elle-même. Des fois, j’avais besoin de précisions, mais ce n’était pas grand-chose. Mais avant de commencer le bouquin, j’ai demandé une bourse mobilité à ALCA pour me rendre sur place. Ça se passait à Hambourg et j’y étais allée une fois, mais seulement un week-end et je ne connaissais pas du tout la ville. Or la ville jouait un rôle central dans le livre, surtout un quartier en particulier de Hambourg que je n’avais jamais vu de ma vie. Du coup, j’ai eu cette bourse et avec l’autrice, on s’est donné rendez-vous dans le quartier où ça se passait, et c’était super sympa. C’était un quartier hyper alternatif. C’était vraiment nécessaire de s’imprégner des lieux avant de commencer le travail. Et ça m’a bien aidée pour traduire.
– Janique : Pour Jennifer Haigh, d’habitude, ça se passe à Boston : Boston, ça va, je connais. Mais le dernier se passe à Shanghai. J’aurais peut-être pu demander une bourse ! Shanghai, je suis perdue, je passe mon temps à chercher sur internet. J’ai même acheté un guide de Shanghai.
– Lise : Moi, ça m’arrive très souvent de regarder dans Google Maps avec les images satellite pour pouvoir rentrer dans les rues. Une des choses les plus difficiles en traduction, je trouve, c’est la description des espaces. Et ce que font les gens dans ces espaces : il faut vraiment pouvoir se l’imaginer très bien pour traduire. Quand on lit, on n’a pas besoin de tout comprendre, mais pour traduire, si.
– Alexia : Avec mes étudiants en allemand, j’ai fait tout le semestre sur des auteurs de nature writing. Pour leur devoir, je leur ai donné un texte, mais je leur ai aussi donné des photos pour qu’ils puissent se l’imaginer. Parce que ça parle d’un cimetière en Italie, et tout d’un coup une pyramide émerge. Si tu n’as pas l’image sous les yeux, c’est impossible de comprendre de quoi il est question. Dans le nature writing, ça revient tout le temps. Chez le dernier auteur qu’on a traduit, il y avait ce village, avec un verbe qui n’est pas très courant en allemand, et qui décrit une voûte. On nous disait que le village était fait de voûtes à flanc de colline. À traduire, c’était ultra difficile. On ne voyait pas ce que ça faisait : un bourrelet ? un ourlet ? enlacé, embrassé ? Avec une photo, tu arrives à retrouver l’idée qu’a pu avoir l’auteur en voyant la chose.
– Janique : À Shanghai, à un moment donné, il y a un passage piéton, et le personnage attend qu’il y ait écrit walk pour traverser. Aux États-Unis, c’est walk/don’t walk pour les piétons. Mais à Shanghai, c’est impossible. Jennifer Haigh, elle avait mis ça dans la version originale, parce que pour un lecteur américain c’est la seule façon de comprendre que le feu passe au vert. Donc je suis allée regarder sur internet comment c’était là-bas : c’est des petits bonshommes rouges et verts, exactement comme chez nous. Mais si tu ne vas pas voir, c’est impossible. Et puis à Shanghai, il y a plein de trucs écrits en anglais, des noms de magasins, d’hôtels. Et je ne savais pas si chaque nom de resto, Jennifer l’avait elle-même traduit en anglais, ou si le restaurant avait un nom anglais dès le départ. Donc je lui ai posé beaucoup de questions et je suis allée regarder dans les rues, sur internet. Il y a en effet pas mal de noms écrits en anglais, certains magasins qui sont les mêmes que chez nous.
– Lise : Je m’en suis beaucoup servie pour deux romans qui se passaient à Calcutta, pour comprendre les lieux. J’ai aussi regardé pas mal de vidéos pour la cuisine qui était très présente : des vidéos de recettes, des vidéos des gens qui cuisinent dans des immenses poêles dans la rue…
– Alexia : Même une ville en Allemagne, c’est quand même mieux de connaître les lieux. Berlin, ça ne ressemble à rien d’autre, et ça ne ressemble pas du tout à Hambourg, par exemple. Moi, j’essaie d’aller en Allemagne de temps en temps, sans avoir forcément tout le temps les fonds ni une bourse.
– Lise : Toi, Janique, tu as une autre méthode, je crois, c’est de garder des chats ?
– J : Oui, même si ce n’est pas forcément dans les endroits en rapport avec les livres que je traduis. Mais ça te permet de voyager. Par exemple, j’aimerais bien traduire des bouquins qui se passent en Écosse, où j’ai passé beaucoup de temps. Doug Johnstone, c’est un auteur d’Édimbourg dont j’ai lu tous les livres. Je connais toutes les rues où ça se passe. J’avais proposé un de ses bouquins à des éditeurs, mais ça ne plaisait à personne, et puis finalement, celui que je préfère a été publié par Métailié. Quand j’ai su qu’ils avaient acheté les droits du livre, j’ai hésité à les contacter, mais j’avais déjà trois bouquins qui m’attendaient et je n’avais pas le temps.
[pour lire la suite de l'entretien cliquer ICI]
– Lise : Quels souvenirs gardez-vous de votre première traduction ?
– Janique : Ma première traduction, c’était pour mon mari Nicolas. On était à New York, on venait juste de se rencontrer, et je l’avais emmené là-bas fêter ses trente ans. Je lui ai offert une biographie des Ramones, son groupe préféré. Je ne connaissais pas trop son niveau d’anglais, mais il m’a dit qu’il ne comprenait rien, et il m’a demandé si je ne pouvais pas le lui traduire. Donc c’est ce que j’ai fait. Je bossais la journée, mais le soir, je traduisais. Ce n’était pas très bien traduit, j’allais un peu vite, parce qu’il était pressé de lire. Tous les soirs, je lui traduisais un chapitre, je l’imprimais, je lui posais sur sa table de nuit et le lendemain, il avait son chapitre. Et j’ai trouvé ça génial. Mais ce n’était que pour lui, personne d’autre ne l’a lue à part son frère, je crois.
– Lise : Donc tu n’étais pas encore traductrice ?
– Janique : Pas du tout. À ce moment-là, je faisais des sondages. Mais, en plus de mon boulot, je faisais plein de trucs dans la musique : dans des assos, j’organisais des concerts, j’écrivais dans des fanzines. Quelques années plus tard, une biographie des Fleshtones a été publiée, et c’était mon groupe préféré. Alors j’ai voulu la traduire. Mais c’était long, et je travaillais, donc je crois que j’ai mis quatre ans pour terminer. Mais cette fois-ci, je me suis dit que j’allais m’appliquer et essayer de la proposer à quelqu’un. Elle a été publiée chez Camion blanc. J’en ai d’ailleurs fait une deuxième pour eux, sur les Ramones, écrite par le frère de Joey Ramone. Mais il n’y avait pas grand monde pour relire chez Camion blanc, il n’y avait même pas vraiment d’éditeur. En fait, ils ne paient pas les traducteurs, ce ne sont que des bouquins sur la musique tirés à trois cents exemplaires. La plupart des gens qui traduisent pour eux ne sont même pas traducteurs, et la plupart des bouquins qui sortent chez eux sont illisibles. Mais au moins, cette expérience m’a permis de faire le master de traduction en passant par une validation des acquis professionnels, parce que je n’avais pas de diplôme d’anglais, mais avec des traductions publiées, j’ai pu postuler.
– Alexia : Et d’où venait ton super niveau d’anglais ?
– Janique : J’ai toujours aimé l’anglais, et j’avais un bon niveau au lycée. À la fac, je ne savais pas trop quoi prendre, alors je m’étais inscrite en anglais et en psycho. Mais finalement je n’ai pas trop aimé l’anglais, parce qu’il n’y avait rien sur les États-Unis, et c’était la seule chose qui m’intéressait. Et puis à l’époque, en 1981, à part être prof, on ne proposait aucun autre débouché. Et je ne voulais absolument pas être prof. Donc j’ai laissé tomber et j’ai fait de la psychologie sociale, en me disant que j’aurais plus d’opportunités. Mais je n’ai pas trop trouvé de travail et je n’ai pas trop cherché non plus : la musique m’amusait beaucoup plus, je trouvais ça plus rigolo de manager des groupes. Mais j’adorais l’anglais et puis j’organisais des concerts, j’avais tout le temps des groupes américains ou anglais chez moi. Donc il fallait bien que je parle anglais, et je voulais vraiment pouvoir discuter avec eux. Alors j’ai beaucoup travaillé toute seule, j’avais encore les livres de la fac et je faisais des exercices, de la grammaire. Je lisais le dictionnaire… Et puis j’allais quand même souvent en Angleterre, puis aux États-Unis. J’achetais des bouquins, je lisais la presse musicale anglaise. Enfin bref, j’ai toujours aimé ça, l’anglais.
– Lise : Et toi, Alexia, ta première traduction ?
– Alexia : D’abord, j’ai fait un premier essai en faisant le programme Goldschmidt franco-allemand. C’est un échange entre traducteurs littéraires du français et de l’allemand. Moi, mon parcours était plus classique, j’avais fait le master de traduction ici, à Bordeaux, en allemand. Et au départ, j’avais aussi fait une licence d’anglais en pensant que ça me serait plus utile. Mais c’était mon premier amour, l’allemand. J’adore cette langue, c’est une langue qui parle à mon esprit. J’ai l’impression d’être éveillée quand j’entends parler allemand. Donc j’ai voulu faire ce master de traduction pour avoir quelque chose qui atteste de mon niveau d’allemand. Puis j’ai demandé cette bourse Goldschmidt. Et ça a été le pur bonheur. Ils prenaient cinq Allemands et cinq Français chaque année. On était peu nombreux et on rencontrait des agents littéraires, des éditeurs, et j’ai choisi une auteure que j’ai commencé à traduire. Le livre s’appelait Das Wasser, in dem wir schlafen, ce qui veut dire littéralement « l’eau dans laquelle nous dormons ». C’était une histoire un peu glauque, mais le livre était hyper intéressant. Une partie du programme se déroulait à Arles, et j’en avais discuté avec une éditrice d’Actes Sud qui lisait l’allemand. Elle m’avait dit que quelque chose la gênait chez cette auteure. Elle pensait qu’il y avait une trop grosse part autobiographique dans ce roman pour que ce soit véritablement une écrivaine et qu’elle ait réellement une carrière littéraire. Et elle n’a pas eu complètement tort parce que le livre n’a jamais été acheté par un éditeur français. Et l'auteure a mis des années à écrire son second bouquin, qui était encore plus glauque que le premier, et qui n’a jamais été acheté non plus. C’est dommage car il y avait un truc très prometteur dans ce premier roman, cette poésie glauque. Donc ça a été ma première traduction, mais je n’ai traduit que les cent premières pages pendant le programme Goldschmidt.
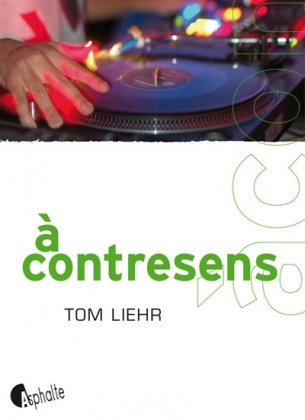 Et à la fin du programme, Claire Duvivier des éditions Asphalte, qui avait un projet de traduction de l’allemand, a proposé à notre promotion de faire un essai sur son projet. Pendant le programme, on travaillait en binôme, une Française et une Allemande, et on s’entendait assez bien. Et c’est notre essai qui a été retenu, et notre traduction a finalement été publiée. Pour un roman allemand, ça a plutôt pas mal marché d’ailleurs. Cette expérience m’a vraiment convaincue que c’était le bon choix, que cette activité me plaisait. Parce qu’en fait j’avais toujours traduit avant : je travaillais dans le jeu vidéo. Mais là, c’était ma première traduction littéraire. Travailler pendant des mois sur un même texte, c’est très différent des studios, où on est toujours dans l’urgence. Et c’est l’époque où ma fille est née, je me suis dit que ce n’était plus possible de travailler comme ça.
Et à la fin du programme, Claire Duvivier des éditions Asphalte, qui avait un projet de traduction de l’allemand, a proposé à notre promotion de faire un essai sur son projet. Pendant le programme, on travaillait en binôme, une Française et une Allemande, et on s’entendait assez bien. Et c’est notre essai qui a été retenu, et notre traduction a finalement été publiée. Pour un roman allemand, ça a plutôt pas mal marché d’ailleurs. Cette expérience m’a vraiment convaincue que c’était le bon choix, que cette activité me plaisait. Parce qu’en fait j’avais toujours traduit avant : je travaillais dans le jeu vidéo. Mais là, c’était ma première traduction littéraire. Travailler pendant des mois sur un même texte, c’est très différent des studios, où on est toujours dans l’urgence. Et c’est l’époque où ma fille est née, je me suis dit que ce n’était plus possible de travailler comme ça.– Lise : Quel serait votre meilleur souvenir et/ou votre pire souvenir de traduction ? Y a-t-il une traduction qui vous a vraiment marquées, que vous avez vécue comme un vrai plaisir, ou au contraire comme une expérience douloureuse, que ce soit à cause du texte lui-même ou parce que les conditions de travail étaient mauvaises, les délais trop serrés par exemple, ou la communication avec l’éditeur compliquée ?
– Alexia : Moi, je traduis encore, souvent, pour un packageur. À chaque fois, je me dis que je ne le ferai plus, mais je continue parce qu’ils me proposent toujours du travail. À force, on a réussi à normaliser nos relations. Mais au début, l’éditrice qui s’en occupe donnait des délais extrêmement serrés. J’essayais de grappiller une semaine, quinze jours, mais c’était rarement plus. Et puis cinq ou six jours avant la date de remise, elle commençait à me harceler au téléphone pour me demander où j’en étais. Un stress horrible ! Parfois, j’ai demandé à des copines de traduire avec moi, mais elles sont devenues folles. Maintenant, ça va mieux. À un moment donné, on était deux ou trois sur un livre, une énorme biographie de Lara Croft. Je trouvais ça stimulant de faire la biographie d’un personnage de fiction, et comme elle existe depuis longtemps, il y avait de la matière. J’avais toute la partie sur les comics, c’était super intéressant. Mais alors les conditions ! À chaque fois on me demande pourquoi je retravaille avec eux. C’est parce qu’ils ont tout le temps des projets. Mais maintenant je suis devenue plus ferme. Je ne démarre la traduction qu’après avoir reçu le premier acompte, parce que des fois, j’ai vraiment été en difficulté : l’éditrice me devait quatre mille euros mais elle traînait, et c’était d’un stress ! Et le travail t’occupe tellement que tu n’as le temps de rien faire d’autre à côté. Et pendant trois mois, il faut travailler sans argent ! Il fallait être à la fois assez calme pour pouvoir traduire paisiblement, tout en gérant le fait de ne pas avoir une seule thune. J’en étais à éviter de passer devant la banque. Il y a vraiment des moments comme ça.
– Lise : C’est ça aussi la traduction pour beaucoup d’entre nous. Il y a souvent un côté précaire : on n’est pas toujours payé dans les temps, on ne sait pas si on va nous redonner du travail...
– Alexia : Moi, ça m’aide à avoir l’esprit tranquille, la traduction, mais j’ai besoin d’avoir l’esprit tranquille aussi pour traduire. Dès que j’ai des pensées parasites qui m’assaillent, le boulot devient horrible. J’ai besoin d’avoir un peu de stabilité.
– Lise : Et toi, Janique ?
– Janique : Moi, je parlerai plutôt de mon meilleur souvenir : ma première traduction littéraire pour Gallmeister. En fait, je rêvais de travailler pour eux, mais ça me paraissait improbable. Tout le monde me disait que ce n’était pas possible. J’ai rencontré Oliver Gallmeister à Lyon, au festival Quais du polar. J’ai été le voir et on a discuté une bonne demi-heure. Et il m’a dit que la maison embauchait rarement, et qu’ils travaillaient toujours avec les mêmes traducteurs. « Mais bon, envoyez votre CV. » Et deux ou trois mois après, ils m’ont appelée pour me proposer une traduction.
– Lise : En ayant juste envoyé ton CV ?
– Janique : On avait beaucoup discuté. Et puis c’est vrai qu’on a à peu près le même âge, même s’il est un peu plus jeune que moi, on aime les mêmes choses. À l’époque ils avaient des auteurs peu connus, par exemple Jake Hinkson. Et justement, je l’avais lu en anglais. Oliver n’y croyait pas, c’était un auteur très peu connu – aux USA, il n’avait vendu que deux cents exemplaires. Donc évidemment, ce genre de choses, ça joue, et puis je connaissais bien la maison d’édition. Donc, d’abord, ils m’ont appelée et ils m’ont fait faire un essai. J’étais super contente. Je me rappellerai toujours ce moment. J’étais en train de faire des courses, je décroche mon téléphone et je n’en crois pas mes oreilles. On partait à New York quinze jours après. Ils m’ont dit que j’avais quinze jours pour traduire je ne sais plus combien de pages, les trois premiers chapitres, je crois. Le stress ! Je fais l’essai, je l’envoie trois jours avant de partir à New York. Et en fait, le lendemain, ils m’ont téléphoné et ils m’ont dit : « C’est bon, vous avez le bouquin. On vous envoie le contrat. Vous partez à New York et vous commencerez la traduction en rentrant. » Et donc voilà, c’était la
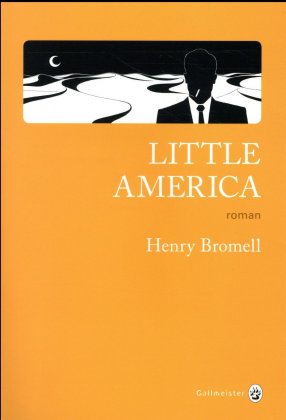 première fois de ma vie qu’il me tardait de rentrer de vacances.
première fois de ma vie qu’il me tardait de rentrer de vacances.Quand je m’y suis mise, je travaillais toute la journée, jusqu’à onze heures du soir. J’étais surexcitée, en fait. Maintenant j’ai des horaires un peu plus calmes. Je ne sortais même plus de chez moi : à un moment donné, je me suis aperçue que je n’étais pas sortie depuis quinze jours tellement j’étais passionnée par ce que je faisais. C’était la première fois que je traduisais de la littérature, et c’était un truc qui me paraissait complètement improbable. J’y pensais déjà quand j’étais ado. J’aurais bien voulu faire ça, mais ça me paraissait impossible.
– Lise : Ah, tu y pensais déjà si jeune ?
– Janique : Oui, je lisais beaucoup de littérature américaine, mais je pensais que c’était un boulot impossible et que les traducteurs, ce n’étaient que des gens nés avec les deux langues. Ado, j’ai lu Catcher in the Rye [L’Attrape-cœurs] en français. Je l’ai lu deux fois de suite, mais je trouvais que certaines choses ne collaient pas. Donc je suis allée en librairie, et je l’ai commandé en anglais. C’est la première fois que je lisais un livre en anglais. Et quand j’ai lu la version originale, forcément j’ai trouvé ça génial. Je l’ai lu deux fois d’affilée. Et c’est là que je me suis dit : la traduction, du coup, c’est impossible. Il y avait tellement de différence entre la version américaine et la traduction. J’avais la première traduction – il y en a trois, mais je n’ai jamais lu la troisième. J’ai acheté la deuxième quand elle est sortie quelques années plus tard, et je n’étais toujours pas satisfaite. Je voyais l’écart entre l’original et la traduction. Et donc pour moi, c’était impossible. Donc j’ai laissé tomber cette idée.
– Lise : Mais pourquoi ça te paraissait impossible ? Ça te paraissait impossible de faire une bonne traduction ?
– Janique : Oui, je me disais que c’était extrêmement compliqué. D’autant plus que le livre n'était compliqué, en apparence. C’était le premier livre que je lisais en anglais, et ça ne me paraissait pas si difficile… C’est d’ailleurs pour ça que c’est très compliqué à traduire justement. Mais à l’époque, je ne me posais pas ce genre de questions. Après, je me suis amusée à traduire des choses dans le fanzine Abus dangereux, je traduisais toutes les interviews, même celles des autres, parce que j’étais une des seules qui maîtrisait un peu l’anglais. Mais je n’avais pas l’intention de faire de la traduction, je traduisais des articles, point final.
– Alexia : Moi, avant de me mettre à la traduction, dans une autre vie, j’habitais en Angleterre. J’avais un petit ami irlandais. Et le soir, je me souviens, il me lisait des livres en anglais : on a commencé avec Terry Pratchett, Les Annales du Disque-monde. C’est sorti chez l’Atalante depuis. Quand il me lisait l’anglais, il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas. C’est un monde complètement imaginaire avec des appareils photo et des petits nains dedans qui peignent… Lui, il était mort de rire. Et chaque fois je l’arrêtais pour qu’il m’explique les blagues et je me disais mais comment ça se traduit, ce genre de trucs ? On a lu aussi Hitchhike to the Galaxy (Le Guide du voyageur galactique en français) et c’est pareil, ce sont des blagues tellement anglaises ! Mon copain passait vingt minutes à m’expliquer une blague, elle était moins drôle au final, mais au moins j’avais compris. Et moi aussi, je m’étais dit : mais c’est impossible de traduire ça, à moins de faire une explication de texte sur dix pages ! À l’époque, j’étais à la fac en Angleterre et je m’étais inscrite pour passer les concours de journalisme. Et puis, pour diverses raisons, ça ne s’est pas fait, mais je crois que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser à la traduction. Depuis le début, j’adore ça, l’humour, mais je trouve que c’est une des grosses difficultés dans la traduction. Dans le premier bouquin que j’ai traduit, il y avait tout un passage que je trouvais très drôle. Moi, la traduction me paraissait drôle, mais l’éditrice me disait qu’en français, ça ne fonctionnait pas du tout. J’avais traduit beaucoup trop littéralement.
– Lise : Alors toi, Janique, tu m’as donné ton meilleur souvenir, et toi, Alexia, le pire, mais ton premier roman chez Asphalte, c’était une bonne expérience, non ?
– Alexia : J’ai adoré travailler sur les deux livres que j’ai traduits pour Asphalte, c’étaient vraiment des bouquins intéressants. Et puis il y avait un vrai travail d’édition. C’est aussi parce que ça s’est bien passé avec eux, en fait. C’est important, le rapport avec l’éditeur, le correcteur : tu as réellement l’impression d’un travail d’équipe. Pour moi, c’est toujours une grosse angoisse de me dire qu’il n’y a que moi qui ai vu le texte. J’adore quand il y a d’autres gens. J’aimerais avoir toujours des gens qui relisent vraiment en détail, mais ce n’est pas toujours le cas, selon les personnes avec qui tu travailles.
– Janique : Chez Gallmeister, ils relisent vraiment. Ils ont des correcteurs employés en interne et leur travail est toujours ultra pertinent. Tu peux discuter, mais quand ils corrigent quelque chose, ce n’est pas pour t’embêter, c’est qu’ils ne laissent rien passer. À la fin, tu sais que plein de gens auront relu ta traduction et que tu vas sortir quelque chose de bien. Parfois on se plante, on loupe une phrase… Et alors justement, du coup, mon pire souvenir, c’était une traduction pour Le Castor astral. Ils m’avaient demandé de traduire une biographie de Manu Chao écrite par un Anglais. J’étais très copine avec Manu Chao, je le connais depuis ses débuts avec les Hot Pants puis avec la Mano Negra. Je les ai vus trente-quatre fois en concert. J’étais tout le temps avec eux à l’époque – maintenant ça fait 25 ans que je ne l’ai pas revu. Donc j’accepte en me disant que ça allait être sympa, et que ça irait vite. Alors je commence à traduire, mais très vite je m’aperçois qu’il y a plein d’erreurs, de noms, de dates. Et il y avait énormément de citations : l'auteur avait repris plein d’articles, d’extraits de livres et de films qu’il avait traduits lui-même en anglais depuis le français. Et à la fin, pas de bibliographie, pas de références. Je lui envoie un message, en lui disant qu’il faut que je retrouve les sources. Toutes les sources étaient françaises, ça venait de Rock & folk, tout ça. Il me dit qu’il a tout jeté, que son éditeur lui avait dit que ça ne servait à rien de tout garder. Moi, j’avais quand même mes propres ressources à la maison, et j’avais gardé tout ce qui était sur la Mano. J’ai récupéré tous les livres et les films qu’il me manquait à la bibliothèque. J’ai retranscrit les films mot à mot. Heureusement, je donnais des cours à la fac cette année-là donc j’avais aussi accès à toutes les publications en ligne. Je faisais des recherches avec des mots-clés. Ça m’a pris un temps fou et je n’ai pas tout retrouvé, peut-être 80 %. C’était bourré d’erreurs et puis c’était mal traduit depuis le français. Donc, j’avais parfois du mal à retrouver la phrase originelle. Moi qui pensais que ce serait simple…
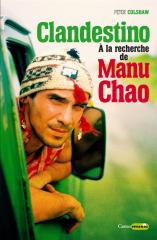 Heureusement, je connaissais leur vie par cœur, et j’étais quand même encore en contact avec les membres du groupe, donc je pouvais leur poser des questions. Finalement, je lui ai corrigé tout son livre et je me suis dit, heureusement que c’est moi qui l’ai fait. En français, au moins, il est sorti sans erreurs. Je l’ai fait relire en entier par Jako, qui était leur tour manager, mais parfois l’auteur décrivait des scènes auxquelles j’avais assisté... C’était un travail de titan, et les éditeurs étaient des potes, donc je ne pouvais pas laisser passer. Le livre a été traduit dans plein de pays et je pense qu’ailleurs, les gens n’ont rien corrigé. Mais en France, beaucoup de gens connaissaient, je ne pouvais pas laisser passer des erreurs comme ça. Donc du coup, ça s’est un peu transformé en cauchemar. Le livre n’était pas long, mais je passais mes week-ends à retranscrire les vidéos…
Heureusement, je connaissais leur vie par cœur, et j’étais quand même encore en contact avec les membres du groupe, donc je pouvais leur poser des questions. Finalement, je lui ai corrigé tout son livre et je me suis dit, heureusement que c’est moi qui l’ai fait. En français, au moins, il est sorti sans erreurs. Je l’ai fait relire en entier par Jako, qui était leur tour manager, mais parfois l’auteur décrivait des scènes auxquelles j’avais assisté... C’était un travail de titan, et les éditeurs étaient des potes, donc je ne pouvais pas laisser passer. Le livre a été traduit dans plein de pays et je pense qu’ailleurs, les gens n’ont rien corrigé. Mais en France, beaucoup de gens connaissaient, je ne pouvais pas laisser passer des erreurs comme ça. Donc du coup, ça s’est un peu transformé en cauchemar. Le livre n’était pas long, mais je passais mes week-ends à retranscrire les vidéos…– Alexia : Vous connaissez ce concept de disruption of credibility ? J’en avais discuté avec un éditeur de science-fiction. C’est hyper important ces petits détails pour rentrer dans l’univers d’un livre. Plus cet univers est éloigné du nôtre, plus il faut que ton lecteur te croie, qu’il se plonge avec toi dans cet univers, et si tu fais des petites erreurs comme ça, tu lui enlèves ce plongeon, le lecteur se rétracte et là, tu le perds. C’est aussi un peu la même chose en traduction : quand tu as super confiance en ton auteur, tu traduis beaucoup plus facilement. Parce que tout ce qui te paraît étrange, ce n’est pas pour rien. Et quand tu commences à avoir des doutes sur la fiabilité de ton auteur, au bout d’un moment, tu ne sais plus si c’est toi ou si c’est lui qui…
– Janique : Oui, ça m’est arrivé avec un autre auteur. Il y avait des erreurs : par exemple, l’histoire se passait dans les années 1950 et il y avait un personnage qui prenait du Valium, alors qu’à l’époque ça n’existait pas. L’auteur était paniqué quand je le lui ai dit, le pauvre. À la fin, je trouvais des solutions toute seule parce que sinon je le faisais trop paniquer. Dans un autre livre, on avait laissé une autre erreur, sur la date de naissance d’un mec, et c’est ma frangine qui l’a vue, mais c’était trop tard. Il était censé avoir fait la guerre du Vietnam, mais il était né en 1969 ! Mais il y en avait tellement que ça nous avait échappé.
– Alexia : Parfois, on ne repère pas l’erreur d’emblée, mais ça crée un malaise. Ton cerveau repère une incohérence, mais tu ne sais pas forcément laquelle. Pour ma première traduction, j’étais mal à l’aise avec les temps. J’en avais discuté avec ma tutrice du programme Goldschmidt et elle aussi, elle s’est mise à se plonger dans mon bouquin. Je me souviens, un soir on était toutes les deux, et elle me dit : ça y est, je sais ! Ça fait onze mois qu’elle est enceinte, la nana ! C’est ça qui nous mettait mal à l’aise. Mais c’était un peu trop vague, il fallait vraiment chercher pour retrouver. Elle était tombée enceinte en septembre, mais en juillet, le bébé n’était toujours pas là. Je n’avais pas repéré l’erreur, mais j’avais ce sentiment de malaise.
– Janique : Maintenant, chez les éditeurs américains, ils ne relisent plus, ils laissent passer beaucoup de choses. Et c’est vrai que, chez certains auteurs, on passe un peu notre temps à corriger.
– Alexia : C’est dingue en fait de se dire qu’une traduction, c’est parfois plus rigoureux. Vous avez lu le livre d’Umberto Eco, Dire presque la même chose ? Je crois que c’est là-dedans qu’il parle de ses traducteurs comme de ses lecteurs les plus attentifs.

– Lise : Et vous, est-ce que vous dialoguez souvent avec vos auteurs ? Ou trouvez-vous que ce n’est pas forcément utile ?
– Janique : Alors moi, ces derniers temps, j’ai fait beaucoup de classiques. Jane Austen, j’aurais bien voulu lui poser des questions parfois, ça m’aurait bien aidée !
– Alexia : Moi, pour les deux romans parus chez Asphalte, c’étaient des contemporains, et pour le premier, l’éditeur avait organisé une tournée de lecture à Paris. Donc on s’est rencontrés. L’auteur est berlinois, et il y avait des mots qui n’existent pas par ailleurs en allemand. Il n’y a pas vraiment de dictionnaires, et parfois je me demandais ce qu’il voulait dire, je ne trouvais ça nulle part. Il a pu m’expliquer des choses, et il m’a même fait des dessins. J’ai le même souci avec mes étudiants en allemand : pour certains textes qui comportent des régionalismes, je suis obligée de leur mimer les choses.
– Janique : J'ai traduit un Canadien auquel j’ai envoyé toute une liste de questions parce que je ne comprenais rien, je ne trouvais les mots nulle part. À l’époque j’avais des copines anglaises à Bordeaux à qui je pouvais demander, mais elles non plus ne comprenaient rien. L’auteur m’a répondu que c’était de l’argot canadien, de la campagne. Heureusement, on
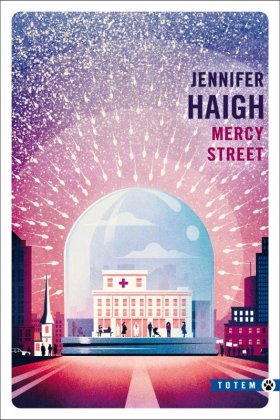 pouvait s’envoyer des messages. Avec Jennifer Haigh, c’est pareil, je lui envoie des messages, et en plus elle parle français couramment. La dernière fois, il y avait des jeux de mots dans un paragraphe, et j’ai dû tout changer, parce que c’était impossible de traduire sans perdre l’esprit du truc. Donc je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je change, mais on se connaît bien. En fait souvent, je me rends compte que les trucs que je ne comprends pas, c’est parce qu’il y a des erreurs. Et j’envoie souvent des messages pour le dire aux auteurs. Elliot Ackerman, c’est pareil, la dernière fois, je me suis rendu compte que je n’avais pas le bon fichier. Sa maison d’édition s’était trompée en envoyant un fichier non corrigé, avec plein d’erreurs. Donc, moi, je m’étais embêtée à relever plein d’erreurs qui, dans la version finale, avaient déjà été corrigées, enfin, pour la plupart…
pouvait s’envoyer des messages. Avec Jennifer Haigh, c’est pareil, je lui envoie des messages, et en plus elle parle français couramment. La dernière fois, il y avait des jeux de mots dans un paragraphe, et j’ai dû tout changer, parce que c’était impossible de traduire sans perdre l’esprit du truc. Donc je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je change, mais on se connaît bien. En fait souvent, je me rends compte que les trucs que je ne comprends pas, c’est parce qu’il y a des erreurs. Et j’envoie souvent des messages pour le dire aux auteurs. Elliot Ackerman, c’est pareil, la dernière fois, je me suis rendu compte que je n’avais pas le bon fichier. Sa maison d’édition s’était trompée en envoyant un fichier non corrigé, avec plein d’erreurs. Donc, moi, je m’étais embêtée à relever plein d’erreurs qui, dans la version finale, avaient déjà été corrigées, enfin, pour la plupart…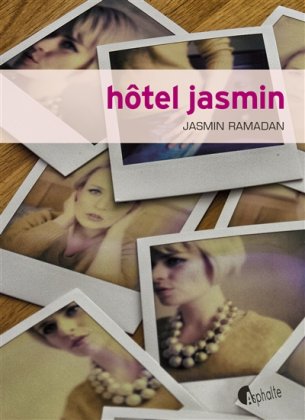 – Alexia : La deuxième autrice que j’ai traduite, je ne l’ai pas trop sollicitée pendant la traduction elle-même. Des fois, j’avais besoin de précisions, mais ce n’était pas grand-chose. Mais avant de commencer le bouquin, j’ai demandé une bourse mobilité à ALCA pour me rendre sur place. Ça se passait à Hambourg et j’y étais allée une fois, mais seulement un week-end et je ne connaissais pas du tout la ville. Or la ville jouait un rôle central dans le livre, surtout un quartier en particulier de Hambourg que je n’avais jamais vu de ma vie. Du coup, j’ai eu cette bourse et avec l’autrice, on s’est donné rendez-vous dans le quartier où ça se passait, et c’était super sympa. C’était un quartier hyper alternatif. C’était vraiment nécessaire de s’imprégner des lieux avant de commencer le travail. Et ça m’a bien aidée pour traduire.
– Alexia : La deuxième autrice que j’ai traduite, je ne l’ai pas trop sollicitée pendant la traduction elle-même. Des fois, j’avais besoin de précisions, mais ce n’était pas grand-chose. Mais avant de commencer le bouquin, j’ai demandé une bourse mobilité à ALCA pour me rendre sur place. Ça se passait à Hambourg et j’y étais allée une fois, mais seulement un week-end et je ne connaissais pas du tout la ville. Or la ville jouait un rôle central dans le livre, surtout un quartier en particulier de Hambourg que je n’avais jamais vu de ma vie. Du coup, j’ai eu cette bourse et avec l’autrice, on s’est donné rendez-vous dans le quartier où ça se passait, et c’était super sympa. C’était un quartier hyper alternatif. C’était vraiment nécessaire de s’imprégner des lieux avant de commencer le travail. Et ça m’a bien aidée pour traduire. – Janique : Pour Jennifer Haigh, d’habitude, ça se passe à Boston : Boston, ça va, je connais. Mais le dernier se passe à Shanghai. J’aurais peut-être pu demander une bourse ! Shanghai, je suis perdue, je passe mon temps à chercher sur internet. J’ai même acheté un guide de Shanghai.
– Lise : Moi, ça m’arrive très souvent de regarder dans Google Maps avec les images satellite pour pouvoir rentrer dans les rues. Une des choses les plus difficiles en traduction, je trouve, c’est la description des espaces. Et ce que font les gens dans ces espaces : il faut vraiment pouvoir se l’imaginer très bien pour traduire. Quand on lit, on n’a pas besoin de tout comprendre, mais pour traduire, si.
– Alexia : Avec mes étudiants en allemand, j’ai fait tout le semestre sur des auteurs de nature writing. Pour leur devoir, je leur ai donné un texte, mais je leur ai aussi donné des photos pour qu’ils puissent se l’imaginer. Parce que ça parle d’un cimetière en Italie, et tout d’un coup une pyramide émerge. Si tu n’as pas l’image sous les yeux, c’est impossible de comprendre de quoi il est question. Dans le nature writing, ça revient tout le temps. Chez le dernier auteur qu’on a traduit, il y avait ce village, avec un verbe qui n’est pas très courant en allemand, et qui décrit une voûte. On nous disait que le village était fait de voûtes à flanc de colline. À traduire, c’était ultra difficile. On ne voyait pas ce que ça faisait : un bourrelet ? un ourlet ? enlacé, embrassé ? Avec une photo, tu arrives à retrouver l’idée qu’a pu avoir l’auteur en voyant la chose.
– Janique : À Shanghai, à un moment donné, il y a un passage piéton, et le personnage attend qu’il y ait écrit walk pour traverser. Aux États-Unis, c’est walk/don’t walk pour les piétons. Mais à Shanghai, c’est impossible. Jennifer Haigh, elle avait mis ça dans la version originale, parce que pour un lecteur américain c’est la seule façon de comprendre que le feu passe au vert. Donc je suis allée regarder sur internet comment c’était là-bas : c’est des petits bonshommes rouges et verts, exactement comme chez nous. Mais si tu ne vas pas voir, c’est impossible. Et puis à Shanghai, il y a plein de trucs écrits en anglais, des noms de magasins, d’hôtels. Et je ne savais pas si chaque nom de resto, Jennifer l’avait elle-même traduit en anglais, ou si le restaurant avait un nom anglais dès le départ. Donc je lui ai posé beaucoup de questions et je suis allée regarder dans les rues, sur internet. Il y a en effet pas mal de noms écrits en anglais, certains magasins qui sont les mêmes que chez nous.
– Lise : Je m’en suis beaucoup servie pour deux romans qui se passaient à Calcutta, pour comprendre les lieux. J’ai aussi regardé pas mal de vidéos pour la cuisine qui était très présente : des vidéos de recettes, des vidéos des gens qui cuisinent dans des immenses poêles dans la rue…
– Alexia : Même une ville en Allemagne, c’est quand même mieux de connaître les lieux. Berlin, ça ne ressemble à rien d’autre, et ça ne ressemble pas du tout à Hambourg, par exemple. Moi, j’essaie d’aller en Allemagne de temps en temps, sans avoir forcément tout le temps les fonds ni une bourse.
– Lise : Toi, Janique, tu as une autre méthode, je crois, c’est de garder des chats ?
– J : Oui, même si ce n’est pas forcément dans les endroits en rapport avec les livres que je traduis. Mais ça te permet de voyager. Par exemple, j’aimerais bien traduire des bouquins qui se passent en Écosse, où j’ai passé beaucoup de temps. Doug Johnstone, c’est un auteur d’Édimbourg dont j’ai lu tous les livres. Je connais toutes les rues où ça se passe. J’avais proposé un de ses bouquins à des éditeurs, mais ça ne plaisait à personne, et puis finalement, celui que je préfère a été publié par Métailié. Quand j’ai su qu’ils avaient acheté les droits du livre, j’ai hésité à les contacter, mais j’avais déjà trois bouquins qui m’attendaient et je n’avais pas le temps.
[pour lire la suite de l'entretien cliquer ICI]

