Entretien avec Lise Chapuis, traductrice de Malacqua de Nicola Pugliese, récemment paru aux éditions Do.
par Julia Polack de Chaumont
Traductrice de l’italien depuis une trentaine d’années, docteure en littérature française et comparée, Lise Chapuis a été enseignante et formatrice. Elle se dédie aujourd'hui entièrement à son travail de «passeur» et anime régulièrement des ateliers de traduction. Elle a fait connaître aux lecteurs français certaines des voix les plus intéressantes de la littérature italienne contemporaine. Nous lui devons notamment la découverte des premiers textes du grand Antonio Tabucchi (à commencer par Nocturne indien, récompensé par le Prix Médicis Étranger en 1987), le roman sur la mafia sicilienne Malacarne de Giosuè Calaciura, dont Jérôme Ferrari dit qu’il a « changé [sa] manière d’écrire », un passionnant et atypique spectre d’auteurs dans la collection Selva Selvaggia qu’elle dirige aux Éditions de l’Arbre vengeur, à Bordeaux. Et tout récemment, un savoureux et hypnotique roman, l’unique roman du Napolitain Nicola Pugliese, Malacqua. Quatre jours de pluie dans la ville de Naples dans l’attente que se produise un événement extraordinaire : un véritable « chef d’œuvre inconnu », publié en 1976 par Italo Calvino alors directeur de collection chez Einaudi, dont l’auteur refusa toute réimpression de son vivant – seules subsistaient quelques rares exemplaires très convoités par des lecteurs passionnés, lorsqu’ils ne devaient pas se contenter de photocopies ! Malacqua a été enfin réédité en 2013 chez Tullio Pironti Editore, avant d’être traduit en anglais, puis en français, aux éditions Do début novembre.
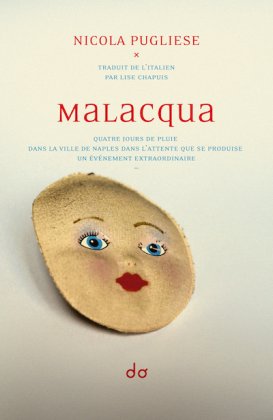 Comment s’est passée votre rencontre avec le roman de Nicola Pugliese, Malacqua, que nous découvrons enfin en français ?
Comment s’est passée votre rencontre avec le roman de Nicola Pugliese, Malacqua, que nous découvrons enfin en français ?
Malacqua m’a été proposé par Olivier Desmettre, le créateur et directeur des Éditions Do à Bordeaux. Le livre avait été traduit en anglais, avec l’aide de l’Institut culturel italien de Londres, et avait reçu un excellent accueil critique. Lecteur curieux et perspicace, Olivier Desmettre m’a demandé de le lire pour savoir si c’était vraiment intéressant. Et c’était le cas : l’écriture est très particulière, extrêmement sinueuse, répétitive, faite d’une série de monologues intérieurs qui font penser à Joyce. J’y trouvais une difficulté certaine qui n’était pas pour me déplaire, le premier chapitre déjà est vraiment magnifique, une vraie plongée dans l’inconnu [ndlr, le premier chapitre du livre, “Introduction et prologue”, est dans une tonalité différente du reste du texte, le rythme y est plus rapide et accentué par l’utilisation du présent, comme un moment suspendu dans les pensées du personnage principal, le journaliste Carlo Andreoli].
Comment vous êtes-vous préparée pour cette traduction ?
J’étais intriguée par le fait que le livre ait disparu des librairies pendant près de trente ans, qu’il ait été écrit par un auteur journaliste qui n’a jamais cherché la gloire, un drôle de caractère puisqu’il n’a jamais voulu retoucher une ligne alors que c’était son premier roman ! Il s’était retiré de Naples et était allé vivre dans la campagne, au calme, ne cherchant ni les cercles littéraires ni la notoriété, même lorsqu’on lui a proposé de réimprimer.
D’autre part, au-delà de sa qualité intrinsèque, ce livre s’avérait être en correspondance avec toute une littérature sur Naples, qui est un univers en soi. En ces temps où l’on lit Elena Ferrante par exemple, ou bien Roberto Saviano, admirateur de Pugliese et de Malacqua, donner à voir d’autres aspects de la ville était donc pertinent. J’ai fait quelques recherches documentaires sur le livre et l’auteur, relu un peu d’Ulysse de James Joyce (en traduction) pour voir comment ça marchait, regardé des extraits du film de Vittorio De Sica, Le Jugement dernier, qui parle aussi d’une pluie sur Naples. On peut naturellement traduire sans se livrer à ce genre de travail préliminaire, en plongeant directement dans le texte, et cela m’arrive souvent aussi, mais j’aime parfois m’immerger dans un contexte, voir dans quoi le livre germe : c’est comme une fleur qui sort d’un riche terreau, il me vient la curiosité de savoir ce qui lui donne naissance, surtout s’il s’agit d’une fleur unique comme celle-ci.
Le texte est très particulier. Vous parlez de cette phrase sinueuse, elle a un rythme, est souvent longue, faite d’énumérations, d’un flux de pensée qui va d’un personnage à un autre, mélange des formules parfois très protocolaires et des incursions de l’oralité. C’est très ancré, géographiquement, politiquement, socialement, c’est un panorama de la société napolitaine, d’un côté les instances, de l’autre le peuple. Est-ce que cela a fait partie des difficultés de traduction ?
Nicola Pugliese est un journaliste et son texte, tout en étant extrêmement et consciemment littéraire, est aussi celui d’un journaliste : on a l’impression que ce sont de petites interviews, comme s’il avait fait parler le concierge, la jeune fille qui attend le bus, le propriétaire du bar... Il prend des personnages et leur donne une voix, mais c’est une voix intérieure, et le livre se révèle être pour une grande partie une mosaïque de flux de pensée verbalisées. En tant que journaliste, il devait également assister aux séances du conseil municipal et là entre en scène le discours officiel, la phraséologie politique, le « burocratese » comme on dit en Italie. Pour le traducteur, tenter de donner vie à ces différents styles et langages est un travail intéressant, qui demande de changer de posture énonciative à chaque nouveau personnage.
Et pourtant il y a une vraie harmonie du texte…
Oui, l’harmonie est en particulier dans la correspondance entre la répétitivité de la phrase et celle de la pluie, qui ne s’arrête jamais. Ce sont des bouts de phrases mais qui s’assemblent, continuent, repartent, comme les filaments de pluie. Mais l’italien supporte plus facilement la répétition que le français, et il faut faire attention à ne pas tomber dans la lourdeur.
Avez-vous trouvé cette traduction particulièrement difficile ?
Pas facile en tout cas. Il fallait trouver l’équilibre entre le flux de conscience intérieure qui se déroule et le rendu presque oralisé, haché parfois, du surgissement des pensées, laisser filer des phrases assez longues… et pourtant les couper. Jusqu’au dernier moment j’ai ajouté, enlevé des virgules. Pauvre Olivier Desmettre ! À un moment donné, on a dit : « Allez, on y va ».
 Qu’est-ce qui séduit la traductrice en vous, est-ce la langue, le ton, l’univers, le contexte ?
Qu’est-ce qui séduit la traductrice en vous, est-ce la langue, le ton, l’univers, le contexte ?
Le goût des textes et le goût des mots, et puis la navigation entre les langues, c’est vraiment ce qui m’a amenée à la traduction. La lecture, d’abord en italien ; voir ensuite ce que le texte va devenir en français à travers la récriture, assister à sa métamorphose et être l’auteure de celle-ci, voilà ce qui est passionnant. C’est comme ça que j’ai commencé avec ma première traduction, Femme de Porto Pim d’Antonio Tabucchi : ce texte, à ce moment-là, m’avait captivée et j’avais envie de le faire lire à d’autres, la seule solution était de le traduire, et j’ai eu la chance de pouvoir le faire !
Ensuite, ce qui compte, c’est faire de cette rencontre avec un livre un projet littéraire. Ce livre a une genèse, une langue, un style : comment je choisis de le transporter d’une langue à l’autre, c’est ça, traduire.
Quel regard portez-vous sur la traduction achevée, avez-vous le sentiment de retrouver le même livre que celui que vous avez découvert en tant que lectrice, ou d’arriver ailleurs ?
J’essaie de faire en sorte que mon impression soit la même, ou plutôt semblable. C’est mon projet : pas qu’il soit une copie – c’est naturellement impossible car les langues ne sont pas plus superposables que les mondes qu’elles portent – mais qu’il produise un effet similaire sur moi (et d’autres lecteurs) en français tout en gardant un accent d’étrangeté. Pour moi, en tant qu’auteur second – bien sûr, on ne ravit pas la primauté à l’écrivain de l’œuvre originale, toutefois on produit un texte qui n’est plus l’original –, le traducteur doit lui aussi avoir un projet littéraire, une réflexion autour de l’œuvre, de sa création et re-création.
Comment situez-vous Malacqua dans votre œuvre de traductrice ? Vos traductions résonnent-elles les unes avec les autres, avez-vous le sentiment d’une sorte de cohérence ?
J’ai tendance à privilégier les textes qui m’intriguent, qui me posent des problèmes, d’où mon intérêt pour Malacqua. J’aime certains univers, mais en fait je peux apprécier des textes très différents. Par exemple, j’ai traduit pour les éditions Christian Bourgois Ce que savent les baleines de Pino Cacucci, un livre de voyage dans la Basse-Californie, plein d’anecdotes, pour lequel j’ai cherché des noms de cactus, des noms de spots de surf, regardé une nuit entière toutes les big waves du monde sur internet ! Ce livre n’a rien à voir avec Malacqua et j’ai pourtant pris un grand plaisir à le traduire : un autre voyage dans des mots.
Pour les éditions de l’Arbre vengeur, ce sont des textes parfois plus bizarres, curieux disons.

Justement, vous dirigez une collection d’auteurs italiens à l’Arbre vengeur, Selva Selvaggia. Y a-t-il des affinités entre la traductrice et la directrice de collection? Pouvez-vous nous parler par exemple du Livre des monstres de Juan Rodolfo Wilcock, paru en mai 2018, que vous avez traduit également ? Le site de l’Arbre vengeur précise: «Écrivain argentin devenu italien pour ses œuvres en prose» !
Directrice de collection c’est un grand mot, je dois en être à sept ou huit textes… mais j’espère bien continuer ! C’est une espèce d’accord d’agrément avec les éditeurs de L’Arbre vengeur, David Vincent et Nicolas Étienne, qui me laissent faire cette collection depuis quelques années. Elle doit bien sûr correspondre à la ligne de la maison. Je lis beaucoup et trouve parfois un texte en me disant « tiens, ça serait bien pour mes camarades de L’Arbre vengeur ! » Eux ce sont des dénicheurs, ils aiment les textes curieux, ils ont des collections de livres oubliés, de bizarreries littéraires, des textes d’anticipation, ou ironiques, ou grotesques, ou tout cela à la fois. Une vraie mine. Et toujours de belles écritures.
En ce qui concerne Juan Rodolfo Wilcock, c’est un peu un auteur culte. Un personnage intéressant. Il a joué dans le film de Pasolini, L’Évangile selon Saint Matthieu. Une de mes amies italiennes, qui connaissait l’acteur principal, a tout de suite réagi quand je lui ai parlé de Wilcock ; un jeune libraire italien auquel je parlais de mes prochains travaux était également un grand admirateur de cet écrivain. Deux lecteurs d’âge différent... Wilcock gravitait dans l’entourage de Jorge Luis Borges, il a ce goût des textes courts, des biographies imaginaires, tout un courant qui aboutit à des écrivains récents comme Roberto Bolaño (je pense ici par exemple à La Littérature nazie en Amérique du Sud). Le Livre des monstres, ce sont des portraits imaginaires de monstres imaginaires, mais qui ont bien à voir avec l’humain : une réflexion désenchantée sur l’humain en même temps qu’une satire – une satire qui peut aussi être une critique de l’Italie d’une époque.
Wilcock a un parcours singulier : il a commencé par écrire de la poésie en espagnol en Argentine (où il est né, de père anglais et de mère italienne), puis est venu en Europe avec Adolfo Bioy Casares et Silvina Ocampo. Il a été un grand traducteur aussi et cette idée me plaît beaucoup ! De l’allemand, du français, de l’anglais. Puis il s’est installé en Italie à partir de 1957 et c’est en italien qu’il a écrit son œuvre en prose, publiée aux éditions Adelphi. En France, certaines traductions avaient été publiées chez Gallimard (Le Stéréoscope des solitaires, La Synagogue des iconoclastes, Le Chaos et Le Temple étrusque), avec leur lot d’amateurs inconditionnels. Tout cela nous intéressait beaucoup, les éditeurs de l’Arbre vengeur et moi. Pour cette traduction-ci, j’ai dû faire quasiment le contraire de Malacqua : des petits textes brefs, des portraits ciselés, avec une chute finale. À chaque fois, un petit objet percutant, un autre défi.
C’est courageux de la part des éditeurs de L’Arbre vengeur d’avoir une collection de textes traduits (et je devrais dire deux, puisqu’à côté de « Selva Selvaggia », il y a une collection de textes de langue espagnole, « La forêt invisible »). Essentiel aussi : une ouverture large sur le monde.
La première parution de « Selva Selvaggia », la collection italienne, était une réédition de deux très beaux récits du XIXe siècle, de Edmondo De Amicis, sous le titre de Vertiges de l’amour ; ensuite, avec La Léda sans cygne de Gabriele D’Annunzio, une vision d’Arcachon au tournant du siècle, un bibelot d’époque au style brillant et acide à la fois. Puis des auteurs contemporains, et ce sont toujours des objets originaux : Boccacce de Marco Lodoli – un auteur un peu négligé en France après plusieurs belles parutions chez P.O.L. –, une galerie de portraits corrosifs d’acteurs du milieu du livre ; Le Chien Iodok d’Aleksej Meshkov, une sorte de récriture saisissante de Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov, qui a été malheureusement ignoré par la critique. La Maison du soulagement mental de Francesco Permunian est un texte grotesque et sombre, une vision féroce de la province italienne. Je voudrais vraiment continuer à traduire cet auteur, je tiens à faire découvrir des écrivains originaux qui donnent une vision complexe de la production littéraire italienne, mais restent hors des circuits des plus grandes maisons d’édition. Les livres de cette collection, ce sont comme des coquillages, on ne ramasse pas dans ces marges que de banals cailloux…
Quant à mes autres collaborations régulières, je peux citer entre autres Brigitte Bouchard, aux Allusifs d’abord et chez Notabilia ensuite, une grande découvreuse pour qui je traduis les textes de Giosuè Calaciura ; ou bien sûr les Éditions Christian Bourgois pour lesquelles j’ai traduit un certain nombre de textes d’Antonio Tabucchi, et d’autres auteurs aussi, comme Rosa Matteucci, une styliste remarquable.
Vous avez également traduit quelques livres pour la jeunesse ?
Oui, je m’intéresse aussi à la littérature de jeunesse et me suis d’ailleurs occupée pendant plusieurs années d’un diplôme universitaire spécialisé dans ce domaine. Pour la jeunesse, j’ai plusieurs projets mais j’ai jusqu’à ce jour traduit seulement quelques titres de Beatrice Masini : Le Dernier Été publié par La Joie de lire, un très joli roman d’ambiance, un été d’enfance finissante, dont le titre italien L’Estate gigante était très poétique ; et puis une série vive et intelligente, chez Milan Jeunesse, Zoé et Zéphyr. Beatrice Masini a une très belle écriture, une attention poétique aux détails. Et il ne faut pas croire que traduire (ou écrire) pour la jeunesse est chose facile ! Il faut arriver aux mots justes et ne pas sous-estimer les enfants, ne pas les priver d’un lexique recherché, de certaines difficultés, sinon on ne voit pas où ils développeraient un sentiment littéraire… Chez Milan également, j’ai fait une adaptation de Pinocchio, avec de superbes images de Maurizio Quarello, un vrai régal pour moi, c’est un tel livre fondateur en Italie, ça m’a passionnée d’essayer d’en rendre l’esprit. Pour ce travail, j’ai consulté de nombreuses versions et adaptations du livre de Collodi, des films aussi, notamment celui de Comencini, dont je me suis inspirée pour donner de la rapidité au récit.

Antonio Tabucchi et (la toute jeune) LIse Chapuis.
Quelle a été votre plus belle expérience de traduction ?
C’est difficile de répondre… Disons que la toute première a été assez marquante. Il y avait une conjonction de choses que j’aime, les îles, la mer, les bateaux, sans doute est-ce très banal, mais c’était lié en particulier à une période de ma vie où j’avais vécu aux Antilles. Ça ne suffit pas bien entendu, mais Femme de Porto Pim est fait comme un archipel, un archipel littéraire. Chaque texte a une identité propre, comme les îles des Açores dont parle le livre, et il fallait lui conserver cette particularité. Pour le texte « Haute mer », je me souviens avoir rencontré la directrice du Musée océanographique de la Rochelle pour m’informer et distinguer les noms des cétacés. Il y a aussi un pastiche de récit de voyage, d’un texte de l’Antiquité, des citations de Michelet... Il fallait naviguer de lecture en lecture, reconstituer un autre archipel de textes, chose que j’aime beaucoup. Et puis chez Tabucchi, il y a comme une ligne d’horizon qui a l’air assez claire, mais il faut sentir tout ce qu’il y a sous cette ligne, la profondeur. Je crois que cette première traduction, comme celle du Nocturne indien que j’ai faite au même moment et qui a obtenu le prix Médicis étranger, a été la découverte d’un profond plaisir : celui de pouvoir travailler en littérature, dans la chair de la langue, en étant lectrice, et créatrice dans une certaine mesure, sans avoir toutefois la responsabilité de l’origine de l’œuvre.
Une autre de mes belles expériences de traduction a été Malacarne de Giosuè Calaciura. C’est le monologue d’un homme de la mafia qui s’adresse à un juge – mais ils sont morts tous les deux – et qui dévide dans une langue flamboyante une litanie de crimes horribles et toute l’histoire de la Sicile ; certaines phrases s’étirent sur quasiment une page : comment faire avec ce flux presque épique, et baroque aussi ? Plein de questions se posaient. Il m’a fallu vraiment trouver un style, décider comment récrire ça en français, un travail passionnant.
Sur quels textes travaillez-vous en ce moment ?
 Sur un nouveau texte de Giosuè Calaciura justement, Borgo Vecchio (prévu chez Notabilia en 2019). C’est un très beau récit sur un quartier de Palerme, un quartier en marge, j’ai envie de le comparer à un livret d’opéra, avec des types de personnages presque stylisés, le voleur, la prostituée, le fraudeur, le traître, et une tristesse à la Dickens sans misérabilisme. C’est un texte fort en couleurs, avec une écriture formidable qui porte tout à un autre niveau. Je vais aller voir l’auteur à Rome, c’est l’occasion de discuter, parfois demander un éclaircissement, quand on peut le faire.
Sur un nouveau texte de Giosuè Calaciura justement, Borgo Vecchio (prévu chez Notabilia en 2019). C’est un très beau récit sur un quartier de Palerme, un quartier en marge, j’ai envie de le comparer à un livret d’opéra, avec des types de personnages presque stylisés, le voleur, la prostituée, le fraudeur, le traître, et une tristesse à la Dickens sans misérabilisme. C’est un texte fort en couleurs, avec une écriture formidable qui porte tout à un autre niveau. Je vais aller voir l’auteur à Rome, c’est l’occasion de discuter, parfois demander un éclaircissement, quand on peut le faire.
Pour les Éditions Christian Bourgois, je viens de finir la traduction de Robledo de Daniele Zito (qui sortira en février 2019). Un roman qui développe une sorte d’hypothèse tout à fait étonnante, à partir d’un reportage fictif consacré à des personnes sans emploi qui décident un jour de travailler clandestinement jusqu’à l’épuisement de leurs ressources et le suicide envisagé comme fin de parcours. Ce texte pose de manière complexe la question de l’engagement dans le travail, de sa place dans la relation au monde, du lien au salaire, des théories et interprétations politiques. Il est porté par une élaboration littéraire sophistiquée, car il se présente comme l’édition des archives d’un journaliste ayant enquêté sur ce phénomène du travail pour le travail. On a donc un faux dossier, de fausses interviews, de fausses bibliographies – et je me suis entre autre amusée à forger des pastiches de titres d’ouvrage et de noms d’éditeurs. … J’y crois beaucoup, j’espère qu’il va marcher !
Pouvez-vous nous parler de la vie autour d’une traduction, l’avant, l’après, si vous avez un exemple ?
Je pourrais citer l'anecdote récente du tournage d’un documentaire sur Francesco Permunian, dont j’ai traduit La Maison du soulagement mental. Paolo Jamoletti, le réalisateur, est venu m’interviewer, je suis allée en Italie pour la projection, ai rencontré l’auteur et aussi, en cette occasion, de merveilleux créateurs de marionnettes... Mais en fait, il y a toujours beaucoup de choses autour d’une œuvre qu’on traduit, depuis les premières recherches qu’on peut faire, les questions qu’on se pose et qu’on va poser à un certain nombre de personnes, pour éclaircir le sens de certains mots, situations, contextes, jusqu’aux échanges avec les correcteurs, tout à fait utiles et qui nous font revenir sur le travail, jusqu’aux rencontres avec des lecteurs, des critiques, en passant par la rédaction de quatrièmes de couvertures ou d’articles.
Il y a parfois des relations profondes qui se créent, des traces émouvantes qui restent, par exemple j’ai retrouvé récemment des cartes postales, des mots, des photos d’Antonio Tabucchi.
Et il faudrait parler aussi des rencontres avec des auteurs et des éditeurs, des contacts avec des collègues traducteurs français et étrangers sur des forums, dans des associations comme l’ATLF ou ATLAS, parler des interventions qu’on peut être amenés à faire, par exemple des ateliers de traduction (en Nouvelle-Aquitaine, en particulier, avec des lycéens) : en fait un puissant réseau qui se tisse autour de la littérature, et qui finit aussi par retrouver sa place dans des sites comme celui de Matrana.
Y a-t-il des livres ou des auteurs que vous regrettez de ne pas avoir traduit, ou pu continuer à traduire ?
Il y a deux auteurs italiens contemporains pour lesquels j’ai une profonde admiration. Tommaso Landolfi, qui est traduit et très bien traduit en France, a un univers d’un romantisme sombre et surréel, et une langue magnifique, j’aurais aimé pouvoir y pénétrer par la traduction, car c’est là, je crois, qu’on s’approche au plus près de l’œuvre ; Giorgio Manganelli, quant à lui, est l’inventeur d’une écriture extrêmement originale, métatextuelle et profondément matérielle, comme une matière langagière qui se pense en se créant, un style qui a des affinités avec le baroque aussi, un régal. J’avais traduit pour L’Arpenteur A et B, les interviews impossibles, que m’avait proposé Jean-Baptiste Para. J’aurais volontiers traduit d’autres titres, Le Marécage définitif était d’une splendeur ! Je voulais le proposer, il était déjà en cours de traduction. Il a été fait. Tant mieux.
Auriez-vous une anecdote à nous raconter sur une de vos traductions ?
Une anecdote, je ne sais pas, mais je repense à ceci : quand j’ai commencé à traduire, il n’y avait pas internet. Nocturne indien, de Tabucchi, se passait à Bombay, il me semblait important de me représenter la ville. Aujourd’hui tout se trouve, tout de suite, en street view sur le net ! À l’époque, il fallait chercher en bibliothèque : Inde, Bombay, trouver un guide de la ville, un plan, des photos. Quand je suis allée en Inde quinze ans plus tard, j’étais chez un ami dans le Sud du côté de Pondichéry, mais finalement j’ai voulu au retour passer par Bombay, pour voir ce que j’avais essayé de me représenter alors. Ce n’est peut-être pas les rues qu’a vues l’auteur, ce n’est peut-être pas ce qu’il a voulu raconter, c’est aussi bien d’imaginer, naturellement… mais je ne sais pas pourquoi la rencontre de l’imagination et de l’expérience a été pour moi un moment fort. Peut-être à cause de tout ce que j’avais mis de moi dans cette première traduction.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune traducteur ?
De beaucoup lire… et lire beaucoup. Si chaque texte est unique, il n’en est pas moins en relation avec d’autres, il faut pouvoir saisir ces réseaux, explicites parfois, implicites le plus souvent. Ce que l’on appelle aujourd’hui l’intertextualité est comme la matrice de toute œuvre et nous aussi, traducteurs, nous sommes pris dedans, identifiant des parentés, pressentant des connivences, recherchant des citations, recréant des pastiches, comme ça m’est arrivé dans le récit « Jour de l’an » (L’Ange noir) de Tabucchi avec des textes de Jules Verne ou D’Annunzio. Partir des livres, passer par une traduction et repartir vers les livres.
Propos recueillis par Julia Polack de Chaumont, pour Matrana, 27 novembre 2018.
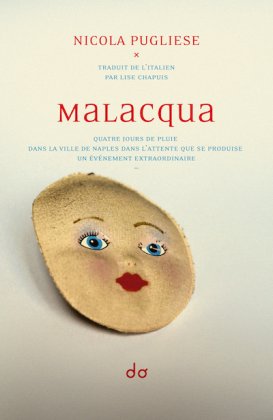 Comment s’est passée votre rencontre avec le roman de Nicola Pugliese, Malacqua, que nous découvrons enfin en français ?
Comment s’est passée votre rencontre avec le roman de Nicola Pugliese, Malacqua, que nous découvrons enfin en français ?Malacqua m’a été proposé par Olivier Desmettre, le créateur et directeur des Éditions Do à Bordeaux. Le livre avait été traduit en anglais, avec l’aide de l’Institut culturel italien de Londres, et avait reçu un excellent accueil critique. Lecteur curieux et perspicace, Olivier Desmettre m’a demandé de le lire pour savoir si c’était vraiment intéressant. Et c’était le cas : l’écriture est très particulière, extrêmement sinueuse, répétitive, faite d’une série de monologues intérieurs qui font penser à Joyce. J’y trouvais une difficulté certaine qui n’était pas pour me déplaire, le premier chapitre déjà est vraiment magnifique, une vraie plongée dans l’inconnu [ndlr, le premier chapitre du livre, “Introduction et prologue”, est dans une tonalité différente du reste du texte, le rythme y est plus rapide et accentué par l’utilisation du présent, comme un moment suspendu dans les pensées du personnage principal, le journaliste Carlo Andreoli].
Comment vous êtes-vous préparée pour cette traduction ?
J’étais intriguée par le fait que le livre ait disparu des librairies pendant près de trente ans, qu’il ait été écrit par un auteur journaliste qui n’a jamais cherché la gloire, un drôle de caractère puisqu’il n’a jamais voulu retoucher une ligne alors que c’était son premier roman ! Il s’était retiré de Naples et était allé vivre dans la campagne, au calme, ne cherchant ni les cercles littéraires ni la notoriété, même lorsqu’on lui a proposé de réimprimer.
D’autre part, au-delà de sa qualité intrinsèque, ce livre s’avérait être en correspondance avec toute une littérature sur Naples, qui est un univers en soi. En ces temps où l’on lit Elena Ferrante par exemple, ou bien Roberto Saviano, admirateur de Pugliese et de Malacqua, donner à voir d’autres aspects de la ville était donc pertinent. J’ai fait quelques recherches documentaires sur le livre et l’auteur, relu un peu d’Ulysse de James Joyce (en traduction) pour voir comment ça marchait, regardé des extraits du film de Vittorio De Sica, Le Jugement dernier, qui parle aussi d’une pluie sur Naples. On peut naturellement traduire sans se livrer à ce genre de travail préliminaire, en plongeant directement dans le texte, et cela m’arrive souvent aussi, mais j’aime parfois m’immerger dans un contexte, voir dans quoi le livre germe : c’est comme une fleur qui sort d’un riche terreau, il me vient la curiosité de savoir ce qui lui donne naissance, surtout s’il s’agit d’une fleur unique comme celle-ci.
Le texte est très particulier. Vous parlez de cette phrase sinueuse, elle a un rythme, est souvent longue, faite d’énumérations, d’un flux de pensée qui va d’un personnage à un autre, mélange des formules parfois très protocolaires et des incursions de l’oralité. C’est très ancré, géographiquement, politiquement, socialement, c’est un panorama de la société napolitaine, d’un côté les instances, de l’autre le peuple. Est-ce que cela a fait partie des difficultés de traduction ?
Nicola Pugliese est un journaliste et son texte, tout en étant extrêmement et consciemment littéraire, est aussi celui d’un journaliste : on a l’impression que ce sont de petites interviews, comme s’il avait fait parler le concierge, la jeune fille qui attend le bus, le propriétaire du bar... Il prend des personnages et leur donne une voix, mais c’est une voix intérieure, et le livre se révèle être pour une grande partie une mosaïque de flux de pensée verbalisées. En tant que journaliste, il devait également assister aux séances du conseil municipal et là entre en scène le discours officiel, la phraséologie politique, le « burocratese » comme on dit en Italie. Pour le traducteur, tenter de donner vie à ces différents styles et langages est un travail intéressant, qui demande de changer de posture énonciative à chaque nouveau personnage.
Et pourtant il y a une vraie harmonie du texte…
Oui, l’harmonie est en particulier dans la correspondance entre la répétitivité de la phrase et celle de la pluie, qui ne s’arrête jamais. Ce sont des bouts de phrases mais qui s’assemblent, continuent, repartent, comme les filaments de pluie. Mais l’italien supporte plus facilement la répétition que le français, et il faut faire attention à ne pas tomber dans la lourdeur.
Avez-vous trouvé cette traduction particulièrement difficile ?
Pas facile en tout cas. Il fallait trouver l’équilibre entre le flux de conscience intérieure qui se déroule et le rendu presque oralisé, haché parfois, du surgissement des pensées, laisser filer des phrases assez longues… et pourtant les couper. Jusqu’au dernier moment j’ai ajouté, enlevé des virgules. Pauvre Olivier Desmettre ! À un moment donné, on a dit : « Allez, on y va ».
 Qu’est-ce qui séduit la traductrice en vous, est-ce la langue, le ton, l’univers, le contexte ?
Qu’est-ce qui séduit la traductrice en vous, est-ce la langue, le ton, l’univers, le contexte ?Le goût des textes et le goût des mots, et puis la navigation entre les langues, c’est vraiment ce qui m’a amenée à la traduction. La lecture, d’abord en italien ; voir ensuite ce que le texte va devenir en français à travers la récriture, assister à sa métamorphose et être l’auteure de celle-ci, voilà ce qui est passionnant. C’est comme ça que j’ai commencé avec ma première traduction, Femme de Porto Pim d’Antonio Tabucchi : ce texte, à ce moment-là, m’avait captivée et j’avais envie de le faire lire à d’autres, la seule solution était de le traduire, et j’ai eu la chance de pouvoir le faire !
Ensuite, ce qui compte, c’est faire de cette rencontre avec un livre un projet littéraire. Ce livre a une genèse, une langue, un style : comment je choisis de le transporter d’une langue à l’autre, c’est ça, traduire.
Quel regard portez-vous sur la traduction achevée, avez-vous le sentiment de retrouver le même livre que celui que vous avez découvert en tant que lectrice, ou d’arriver ailleurs ?
J’essaie de faire en sorte que mon impression soit la même, ou plutôt semblable. C’est mon projet : pas qu’il soit une copie – c’est naturellement impossible car les langues ne sont pas plus superposables que les mondes qu’elles portent – mais qu’il produise un effet similaire sur moi (et d’autres lecteurs) en français tout en gardant un accent d’étrangeté. Pour moi, en tant qu’auteur second – bien sûr, on ne ravit pas la primauté à l’écrivain de l’œuvre originale, toutefois on produit un texte qui n’est plus l’original –, le traducteur doit lui aussi avoir un projet littéraire, une réflexion autour de l’œuvre, de sa création et re-création.
Comment situez-vous Malacqua dans votre œuvre de traductrice ? Vos traductions résonnent-elles les unes avec les autres, avez-vous le sentiment d’une sorte de cohérence ?
J’ai tendance à privilégier les textes qui m’intriguent, qui me posent des problèmes, d’où mon intérêt pour Malacqua. J’aime certains univers, mais en fait je peux apprécier des textes très différents. Par exemple, j’ai traduit pour les éditions Christian Bourgois Ce que savent les baleines de Pino Cacucci, un livre de voyage dans la Basse-Californie, plein d’anecdotes, pour lequel j’ai cherché des noms de cactus, des noms de spots de surf, regardé une nuit entière toutes les big waves du monde sur internet ! Ce livre n’a rien à voir avec Malacqua et j’ai pourtant pris un grand plaisir à le traduire : un autre voyage dans des mots.
Pour les éditions de l’Arbre vengeur, ce sont des textes parfois plus bizarres, curieux disons.

Justement, vous dirigez une collection d’auteurs italiens à l’Arbre vengeur, Selva Selvaggia. Y a-t-il des affinités entre la traductrice et la directrice de collection? Pouvez-vous nous parler par exemple du Livre des monstres de Juan Rodolfo Wilcock, paru en mai 2018, que vous avez traduit également ? Le site de l’Arbre vengeur précise: «Écrivain argentin devenu italien pour ses œuvres en prose» !
Directrice de collection c’est un grand mot, je dois en être à sept ou huit textes… mais j’espère bien continuer ! C’est une espèce d’accord d’agrément avec les éditeurs de L’Arbre vengeur, David Vincent et Nicolas Étienne, qui me laissent faire cette collection depuis quelques années. Elle doit bien sûr correspondre à la ligne de la maison. Je lis beaucoup et trouve parfois un texte en me disant « tiens, ça serait bien pour mes camarades de L’Arbre vengeur ! » Eux ce sont des dénicheurs, ils aiment les textes curieux, ils ont des collections de livres oubliés, de bizarreries littéraires, des textes d’anticipation, ou ironiques, ou grotesques, ou tout cela à la fois. Une vraie mine. Et toujours de belles écritures.
En ce qui concerne Juan Rodolfo Wilcock, c’est un peu un auteur culte. Un personnage intéressant. Il a joué dans le film de Pasolini, L’Évangile selon Saint Matthieu. Une de mes amies italiennes, qui connaissait l’acteur principal, a tout de suite réagi quand je lui ai parlé de Wilcock ; un jeune libraire italien auquel je parlais de mes prochains travaux était également un grand admirateur de cet écrivain. Deux lecteurs d’âge différent... Wilcock gravitait dans l’entourage de Jorge Luis Borges, il a ce goût des textes courts, des biographies imaginaires, tout un courant qui aboutit à des écrivains récents comme Roberto Bolaño (je pense ici par exemple à La Littérature nazie en Amérique du Sud). Le Livre des monstres, ce sont des portraits imaginaires de monstres imaginaires, mais qui ont bien à voir avec l’humain : une réflexion désenchantée sur l’humain en même temps qu’une satire – une satire qui peut aussi être une critique de l’Italie d’une époque.
Wilcock a un parcours singulier : il a commencé par écrire de la poésie en espagnol en Argentine (où il est né, de père anglais et de mère italienne), puis est venu en Europe avec Adolfo Bioy Casares et Silvina Ocampo. Il a été un grand traducteur aussi et cette idée me plaît beaucoup ! De l’allemand, du français, de l’anglais. Puis il s’est installé en Italie à partir de 1957 et c’est en italien qu’il a écrit son œuvre en prose, publiée aux éditions Adelphi. En France, certaines traductions avaient été publiées chez Gallimard (Le Stéréoscope des solitaires, La Synagogue des iconoclastes, Le Chaos et Le Temple étrusque), avec leur lot d’amateurs inconditionnels. Tout cela nous intéressait beaucoup, les éditeurs de l’Arbre vengeur et moi. Pour cette traduction-ci, j’ai dû faire quasiment le contraire de Malacqua : des petits textes brefs, des portraits ciselés, avec une chute finale. À chaque fois, un petit objet percutant, un autre défi.
C’est courageux de la part des éditeurs de L’Arbre vengeur d’avoir une collection de textes traduits (et je devrais dire deux, puisqu’à côté de « Selva Selvaggia », il y a une collection de textes de langue espagnole, « La forêt invisible »). Essentiel aussi : une ouverture large sur le monde.
La première parution de « Selva Selvaggia », la collection italienne, était une réédition de deux très beaux récits du XIXe siècle, de Edmondo De Amicis, sous le titre de Vertiges de l’amour ; ensuite, avec La Léda sans cygne de Gabriele D’Annunzio, une vision d’Arcachon au tournant du siècle, un bibelot d’époque au style brillant et acide à la fois. Puis des auteurs contemporains, et ce sont toujours des objets originaux : Boccacce de Marco Lodoli – un auteur un peu négligé en France après plusieurs belles parutions chez P.O.L. –, une galerie de portraits corrosifs d’acteurs du milieu du livre ; Le Chien Iodok d’Aleksej Meshkov, une sorte de récriture saisissante de Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov, qui a été malheureusement ignoré par la critique. La Maison du soulagement mental de Francesco Permunian est un texte grotesque et sombre, une vision féroce de la province italienne. Je voudrais vraiment continuer à traduire cet auteur, je tiens à faire découvrir des écrivains originaux qui donnent une vision complexe de la production littéraire italienne, mais restent hors des circuits des plus grandes maisons d’édition. Les livres de cette collection, ce sont comme des coquillages, on ne ramasse pas dans ces marges que de banals cailloux…
Quant à mes autres collaborations régulières, je peux citer entre autres Brigitte Bouchard, aux Allusifs d’abord et chez Notabilia ensuite, une grande découvreuse pour qui je traduis les textes de Giosuè Calaciura ; ou bien sûr les Éditions Christian Bourgois pour lesquelles j’ai traduit un certain nombre de textes d’Antonio Tabucchi, et d’autres auteurs aussi, comme Rosa Matteucci, une styliste remarquable.
Vous avez également traduit quelques livres pour la jeunesse ?
Oui, je m’intéresse aussi à la littérature de jeunesse et me suis d’ailleurs occupée pendant plusieurs années d’un diplôme universitaire spécialisé dans ce domaine. Pour la jeunesse, j’ai plusieurs projets mais j’ai jusqu’à ce jour traduit seulement quelques titres de Beatrice Masini : Le Dernier Été publié par La Joie de lire, un très joli roman d’ambiance, un été d’enfance finissante, dont le titre italien L’Estate gigante était très poétique ; et puis une série vive et intelligente, chez Milan Jeunesse, Zoé et Zéphyr. Beatrice Masini a une très belle écriture, une attention poétique aux détails. Et il ne faut pas croire que traduire (ou écrire) pour la jeunesse est chose facile ! Il faut arriver aux mots justes et ne pas sous-estimer les enfants, ne pas les priver d’un lexique recherché, de certaines difficultés, sinon on ne voit pas où ils développeraient un sentiment littéraire… Chez Milan également, j’ai fait une adaptation de Pinocchio, avec de superbes images de Maurizio Quarello, un vrai régal pour moi, c’est un tel livre fondateur en Italie, ça m’a passionnée d’essayer d’en rendre l’esprit. Pour ce travail, j’ai consulté de nombreuses versions et adaptations du livre de Collodi, des films aussi, notamment celui de Comencini, dont je me suis inspirée pour donner de la rapidité au récit.

Antonio Tabucchi et (la toute jeune) LIse Chapuis.
Quelle a été votre plus belle expérience de traduction ?
C’est difficile de répondre… Disons que la toute première a été assez marquante. Il y avait une conjonction de choses que j’aime, les îles, la mer, les bateaux, sans doute est-ce très banal, mais c’était lié en particulier à une période de ma vie où j’avais vécu aux Antilles. Ça ne suffit pas bien entendu, mais Femme de Porto Pim est fait comme un archipel, un archipel littéraire. Chaque texte a une identité propre, comme les îles des Açores dont parle le livre, et il fallait lui conserver cette particularité. Pour le texte « Haute mer », je me souviens avoir rencontré la directrice du Musée océanographique de la Rochelle pour m’informer et distinguer les noms des cétacés. Il y a aussi un pastiche de récit de voyage, d’un texte de l’Antiquité, des citations de Michelet... Il fallait naviguer de lecture en lecture, reconstituer un autre archipel de textes, chose que j’aime beaucoup. Et puis chez Tabucchi, il y a comme une ligne d’horizon qui a l’air assez claire, mais il faut sentir tout ce qu’il y a sous cette ligne, la profondeur. Je crois que cette première traduction, comme celle du Nocturne indien que j’ai faite au même moment et qui a obtenu le prix Médicis étranger, a été la découverte d’un profond plaisir : celui de pouvoir travailler en littérature, dans la chair de la langue, en étant lectrice, et créatrice dans une certaine mesure, sans avoir toutefois la responsabilité de l’origine de l’œuvre.
Une autre de mes belles expériences de traduction a été Malacarne de Giosuè Calaciura. C’est le monologue d’un homme de la mafia qui s’adresse à un juge – mais ils sont morts tous les deux – et qui dévide dans une langue flamboyante une litanie de crimes horribles et toute l’histoire de la Sicile ; certaines phrases s’étirent sur quasiment une page : comment faire avec ce flux presque épique, et baroque aussi ? Plein de questions se posaient. Il m’a fallu vraiment trouver un style, décider comment récrire ça en français, un travail passionnant.
Sur quels textes travaillez-vous en ce moment ?
 Sur un nouveau texte de Giosuè Calaciura justement, Borgo Vecchio (prévu chez Notabilia en 2019). C’est un très beau récit sur un quartier de Palerme, un quartier en marge, j’ai envie de le comparer à un livret d’opéra, avec des types de personnages presque stylisés, le voleur, la prostituée, le fraudeur, le traître, et une tristesse à la Dickens sans misérabilisme. C’est un texte fort en couleurs, avec une écriture formidable qui porte tout à un autre niveau. Je vais aller voir l’auteur à Rome, c’est l’occasion de discuter, parfois demander un éclaircissement, quand on peut le faire.
Sur un nouveau texte de Giosuè Calaciura justement, Borgo Vecchio (prévu chez Notabilia en 2019). C’est un très beau récit sur un quartier de Palerme, un quartier en marge, j’ai envie de le comparer à un livret d’opéra, avec des types de personnages presque stylisés, le voleur, la prostituée, le fraudeur, le traître, et une tristesse à la Dickens sans misérabilisme. C’est un texte fort en couleurs, avec une écriture formidable qui porte tout à un autre niveau. Je vais aller voir l’auteur à Rome, c’est l’occasion de discuter, parfois demander un éclaircissement, quand on peut le faire.Pour les Éditions Christian Bourgois, je viens de finir la traduction de Robledo de Daniele Zito (qui sortira en février 2019). Un roman qui développe une sorte d’hypothèse tout à fait étonnante, à partir d’un reportage fictif consacré à des personnes sans emploi qui décident un jour de travailler clandestinement jusqu’à l’épuisement de leurs ressources et le suicide envisagé comme fin de parcours. Ce texte pose de manière complexe la question de l’engagement dans le travail, de sa place dans la relation au monde, du lien au salaire, des théories et interprétations politiques. Il est porté par une élaboration littéraire sophistiquée, car il se présente comme l’édition des archives d’un journaliste ayant enquêté sur ce phénomène du travail pour le travail. On a donc un faux dossier, de fausses interviews, de fausses bibliographies – et je me suis entre autre amusée à forger des pastiches de titres d’ouvrage et de noms d’éditeurs. … J’y crois beaucoup, j’espère qu’il va marcher !
Pouvez-vous nous parler de la vie autour d’une traduction, l’avant, l’après, si vous avez un exemple ?
Je pourrais citer l'anecdote récente du tournage d’un documentaire sur Francesco Permunian, dont j’ai traduit La Maison du soulagement mental. Paolo Jamoletti, le réalisateur, est venu m’interviewer, je suis allée en Italie pour la projection, ai rencontré l’auteur et aussi, en cette occasion, de merveilleux créateurs de marionnettes... Mais en fait, il y a toujours beaucoup de choses autour d’une œuvre qu’on traduit, depuis les premières recherches qu’on peut faire, les questions qu’on se pose et qu’on va poser à un certain nombre de personnes, pour éclaircir le sens de certains mots, situations, contextes, jusqu’aux échanges avec les correcteurs, tout à fait utiles et qui nous font revenir sur le travail, jusqu’aux rencontres avec des lecteurs, des critiques, en passant par la rédaction de quatrièmes de couvertures ou d’articles.
Il y a parfois des relations profondes qui se créent, des traces émouvantes qui restent, par exemple j’ai retrouvé récemment des cartes postales, des mots, des photos d’Antonio Tabucchi.
Et il faudrait parler aussi des rencontres avec des auteurs et des éditeurs, des contacts avec des collègues traducteurs français et étrangers sur des forums, dans des associations comme l’ATLF ou ATLAS, parler des interventions qu’on peut être amenés à faire, par exemple des ateliers de traduction (en Nouvelle-Aquitaine, en particulier, avec des lycéens) : en fait un puissant réseau qui se tisse autour de la littérature, et qui finit aussi par retrouver sa place dans des sites comme celui de Matrana.
Y a-t-il des livres ou des auteurs que vous regrettez de ne pas avoir traduit, ou pu continuer à traduire ?
Il y a deux auteurs italiens contemporains pour lesquels j’ai une profonde admiration. Tommaso Landolfi, qui est traduit et très bien traduit en France, a un univers d’un romantisme sombre et surréel, et une langue magnifique, j’aurais aimé pouvoir y pénétrer par la traduction, car c’est là, je crois, qu’on s’approche au plus près de l’œuvre ; Giorgio Manganelli, quant à lui, est l’inventeur d’une écriture extrêmement originale, métatextuelle et profondément matérielle, comme une matière langagière qui se pense en se créant, un style qui a des affinités avec le baroque aussi, un régal. J’avais traduit pour L’Arpenteur A et B, les interviews impossibles, que m’avait proposé Jean-Baptiste Para. J’aurais volontiers traduit d’autres titres, Le Marécage définitif était d’une splendeur ! Je voulais le proposer, il était déjà en cours de traduction. Il a été fait. Tant mieux.
Auriez-vous une anecdote à nous raconter sur une de vos traductions ?
Une anecdote, je ne sais pas, mais je repense à ceci : quand j’ai commencé à traduire, il n’y avait pas internet. Nocturne indien, de Tabucchi, se passait à Bombay, il me semblait important de me représenter la ville. Aujourd’hui tout se trouve, tout de suite, en street view sur le net ! À l’époque, il fallait chercher en bibliothèque : Inde, Bombay, trouver un guide de la ville, un plan, des photos. Quand je suis allée en Inde quinze ans plus tard, j’étais chez un ami dans le Sud du côté de Pondichéry, mais finalement j’ai voulu au retour passer par Bombay, pour voir ce que j’avais essayé de me représenter alors. Ce n’est peut-être pas les rues qu’a vues l’auteur, ce n’est peut-être pas ce qu’il a voulu raconter, c’est aussi bien d’imaginer, naturellement… mais je ne sais pas pourquoi la rencontre de l’imagination et de l’expérience a été pour moi un moment fort. Peut-être à cause de tout ce que j’avais mis de moi dans cette première traduction.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune traducteur ?
De beaucoup lire… et lire beaucoup. Si chaque texte est unique, il n’en est pas moins en relation avec d’autres, il faut pouvoir saisir ces réseaux, explicites parfois, implicites le plus souvent. Ce que l’on appelle aujourd’hui l’intertextualité est comme la matrice de toute œuvre et nous aussi, traducteurs, nous sommes pris dedans, identifiant des parentés, pressentant des connivences, recherchant des citations, recréant des pastiches, comme ça m’est arrivé dans le récit « Jour de l’an » (L’Ange noir) de Tabucchi avec des textes de Jules Verne ou D’Annunzio. Partir des livres, passer par une traduction et repartir vers les livres.
Propos recueillis par Julia Polack de Chaumont, pour Matrana, 27 novembre 2018.

